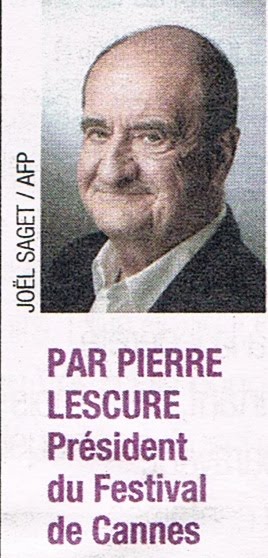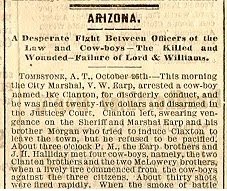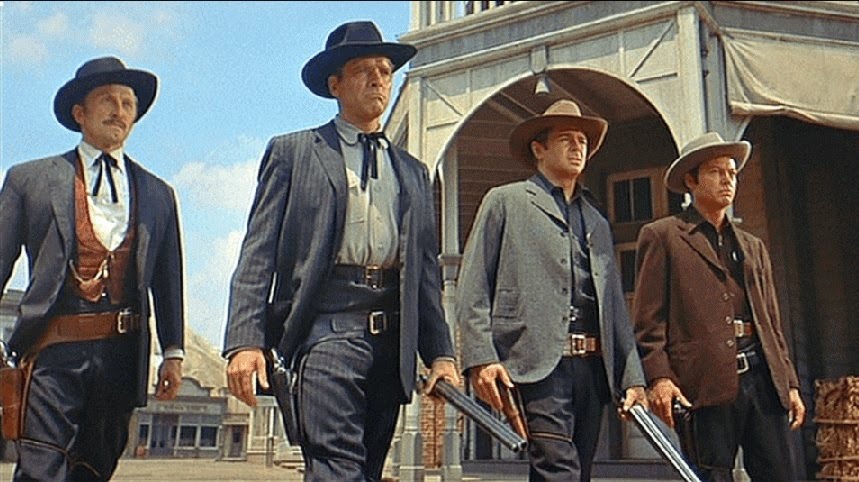publié le 29 déc. 2020, 03:07 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 29 déc. 2020, 03:42
]
une ode à la solidarité Ignoré
lors de sa sortie en salles, ce mélo de Frank Capra devenu un grand
classique des fêtes de fin d’année distille un puissant shoot de bonheur
et d’entraide en ces temps troublés. Des étoiles scintillent au firmament. Sur terre, George
Bailey est prêt à sauter d’un pont. Comment ce père de famille modèle en
est-il arrivé là ? Les anges veillant sur sa destinée vont remonter le
fil de sa vie. Passé sous les radars lors de sa sortie en 1946, La vie est belle
est ensuite devenu LE classique du réveillon de Noël. Diffusée tous les
ans à la télévision américaine, cette madeleine de Proust fait partie
de ces œuvres touchées par la grâce. Frank Capra, Sicilien d’origine,
réalise un mélo émouvant et jamais niais comme Hollywood en avait le
secret. Son personnage principal va traverser les joies et surmonter les
peines de cette première moitié de XX e siècle. Figure sacrificielleInterprété
par James Stewart, plus connu en France pour ses multiples
collaborations avec Alfred Hitchcock, George Bailey coche toutes les
apparences du parfait American Way of Life. Son épouse, séduite par son
humour taquin lors d’une scène culte où elle se retrouve nue dans un
buisson, quatre beaux enfants et son travail sont sources de fierté.
L’homme se dédie corps et âme à une seule mission : fournir des prêts à
taux décents aux concitoyens pour combattre le mal-logement. En face, un
banquier véreux nommé Potter ne songe qu’à faire prospérer le paradis
des taudis. Mais l’idéaliste, en quête d’aventures lointaines, va
progressivement incarner une figure sacrificielle, quasi christique dans
son abnégation. Renonçant à ses rêves pour sauver l’entreprise
familiale, il ne quittera jamais Bedford Falls. Instants poétiques et danses endiabléesDeux
visions de l’Amérique s’opposent ici. Capra, qui tourna des films de
propagande durant la Seconde Guerre mondiale, a choisi son camp en
transcendant le pire. Équilibriste des émotions, cinéaste de la
convivialité, ce catholique fervent veut croire en une époque où le bien
et l’optimisme triomphent. Les danses de charleston endiablées, les
conversations enflammées et les chants résonnent aussi de la légèreté
retrouvée de l’après-guerre. Les instants poétiques, notamment quand
George veut décrocher la lune à sa promise, ou encore la dinde rôtissant
dans la cheminée d’une maison délabrée grâce à un ingénieux système de
tourne-disque, ajoutent une touche de fantaisie à ce conte moral. La
réaction du héros le jour du krach de Wall Street en 1929 résume à elle
seule la posture humaniste du metteur en scène. Alors que les
titulaires d’un prêt veulent récupérer leur argent, George Bailey refuse
et propose de leur distribuer, avec l’aide de sa femme, les
2 000 dollars économisés pour leur voyage de noces. Mais une autre
catastrophe, la perte d’une enveloppe de 8 000 dollars par son oncle,
pourrait à nouveau tout faire basculer…  Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis. Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis.
Grâce à l’irruption de l’ange de seconde classe Clarence, « au QI de lapin », le
bienfaiteur va pouvoir mesurer la cruauté d’un monde sans lui. Frank
Capra, qui croit dur comme fer aux lendemains américains qui chantent,
met un pied dans le fantastique pour professer : « Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis. »
Le happy end – fin joyeuse –, concentré de bons sentiments et
d’embrassades, sans dépasser la dose prescrite, reste dans les annales
du cinéma antidépresseur. En ces temps troublés, ce shoot d’espoir,
doublé d’une puissante réflexion sur la solidarité, devrait accomplir un
petit miracle : réchauffer les cœurs les plus meurtris.
Frank Capra, une légende trop belle pour être vraie Le
réalisateur américain a beaucoup enjolivé ses souvenirs dans ses
Mémoires. Dimitri Kourtchine revient sur ce qu’il a apporté au cinéma et
sur son parcours d’homme. Frank Capra est l’auteur de films bouleversants qui
comptent dans l’histoire du cinéma. Et un homme en perpétuelle
réinvention de sa propre histoire. Dans son épatant documentaire (1),
Dimitri Kourtchine raconte, archives à la clé, comment le réalisateur
phare des années 1930-1940 s’est identifié à une Amérique vécue comme
glorieuse et mythique. Une vision idyllique de l’american way of life Et
le travail de Dimitri Kourtchine touche à la fois par la richesse de
ses archives, la rigueur de ses recherches et la fluidité de sa
narration. En partant de l’autobiographie de Frank Capra, Hollywood Story,
il démonte les raccourcis et la réalité très enjolivée que le
réalisateur s’est et a racontée. Le petit garçon italien, qui a débarqué
à 6 ans avec sa famille aux États-Unis, a connu la misère, enfant. S’il met ses succès sur le dos de la providence et d’une
Amérique qui donne sa chance à tous, la réalité est tout autre : il fut
un acharné du travail, qui a su saisir les bonnes opportunités et
s’entourer des bonnes personnes. Il fut aussi le premier réalisateur à
s’imposer comme auteur de ses films, avec sur les affiches son nom en
grosses lettres au-dessus du titre. Républicain, il a participé à une
vision idyllique de l’american way of life (le mode de vie américain).
Et n’a pas hésité à lâcher ses amis au moment de la chasse aux sorcières
de McCarthy dans l’immédiat après-guerre. Des films qui touchent au coeurMais
ses films, aujourd’hui encore, touchent au cœur. Ses personnages,
auxquels chacun peut s’identifier, ont toujours une force cachée
derrière leur apparente fragilité. Et pas mal d’humour, aussi. Comme
dans La Vie est belle, diffusé à 20 h 50, où le héros du film,
George Bailey (James Stewart), veut mettre fin à ses jours quand un ange
gardien lui montre à quoi ressemblerait sa ville, et la vie de ses
proches, s’il n’avait pas vécu. Ou dans Mr Smith au Sénat, où un simple citoyen se bat contre la corruption organisée du système. Dans l’Extravagant Mr Deeds, où un garçon tout simple (Gary Cooper) triomphe d’avocats véreux par son honnêteté…
(1) "Frank Capra, il était une fois l'Amérique", diffusé sur ARTE, mardi 29 décembre 2020.
NB. lire aussi : "Lady for a day", Frank Capra, 1933.
|
publié le 12 juin 2020, 14:08 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 12 juin 2020, 14:45
]
Voici un article de l'Humanité (12 juin 2020) qui répond à une polémique ridicule à mes yeux.
Racisme. Faut-il brûler Autant en emporte le vent ? Autant
en emporte le vent, qui est le plus gros succès du cinéma au
box-office, est retiré des plateformes de streaming par Warner media,
qui en détient les droits et veut donner un sous-titre explicatif au
film.
Autant en emporte le Vent n’est
pas un documentaire sur la situation des esclaves noirs dans l’Amérique
de la guerre de Sécession, ce qui a visiblement totalement échappé à
HBO. C’est une fresque romanesque, qui raconte l’émancipation d’une
jeune femme de la bonne société sudiste, esclavagiste. Son héroïne,
Scarlett O’Hara est une enfant gâtée, qui va grandir en s’affranchissant
de tous les codes moraux de son époque. Elle est une canaille, comme
dit Rhett Butler, son troisième mari et éternel amoureux, qui en connaît
un sacré rayon sur le sujet. Quand le roman est sorti, en 1936, ce que
Scarlett faisait exploser, c’était aussi le rôle de mère parfaite,
d’épouse qui se tient bien sagement à sa place, celle qui lui est
assignée. Ce qu’avant Scarlett, Margaret Mitchell, son auteure, avait
réalisé. Ce qui nous semble normal aujourd’hui, était alors une petite
révolution.
La libération des esclaves est le prétexte du livre, mais pas son sujet
Margaret Mitchell est née en 1900. Ses grands-parents, ses
parents, ont largement construit ce Sud. Ils dirigeaient le type de
plantations qui asservissaient des hommes et des femmes. Comme celle de
coton des parents de Scarlett, le «Tara» de son roman. Elle-même y a
grandi. Son imaginaire de femme blanche a baigné de toutes ces
représentations, y compris celles du Ku Klux Klan. Pour autant, les
esclaves, dans le livre comme dans le film, n’ont pas, en dehors de Mama
(Hattie McDaniel), la nounou de Scarlett, de place centrale. Leur
libération est le prétexte du livre, mais pas le sujet. Donc, oui,
Margaret Mitchell les représente dociles, leur donne un langage indigne.
Ce n’est pas une excuse, mais Margaret Mitchell était une femme blanche
privilégiée d’un autre temps que le nôtre. Ce qui est embêtant, et ce
n’est pas la faute d’Autant en emporte le vent, ce sont ces schémas mentaux qui durent.
En Georgie, dont l'auteure est originaire, le 23 février
dernier, Ahmaud Arbery a été abattu par un ancien policier et son
fils. Il était noir, et il courait, ce qui parait logique quand on fait
un jogging: un motif suffisant pour être assassiné. C’est dire l’ancrage
de ce racisme, 155 ans après la fin de la guerre de Sécession, 52 ans
après le Civil Rights Act qui donne un coup d’arrêt, dans les textes,
aux lois ségrégatives. Georgie : études électorales (mid-term 2018) -3ème partie-
Hattie McDaniel, Big Mamma, première femme noire à avoir obtenu un Oscar
Pour autant, faut-il jeter Scarlett O’Hara, ce film et ce
livre aux orties ? La réponse est non. Ils sont les témoins de leur
temps, pas du nôtre. Ce film est majeur, à bien des égards, dans
l’histoire du cinéma. Le premier film en technicolor, des moyens
démentiels pour filmer l’incendie d’Atlanta, la scène mythique où sont
étalés les blessés de la bataille de Pittsburgh... Un casting incroyable
avec Clark Gable, Vivien Leigh et Olivia de Havilland au générique.
Pour ce film, Hattie McDaniel, sera la première femme noire à avoir
obtenu un Oscar. Ségrégation oblige, elle n’a pas été invitée à la
projection du film, et a pu raisonner Clark Gable de ne pas la
boycotter. Il a fallu que David O Selznick, le producteur du film,
menace, pour qu’elle puisse entrer à la cérémonie des Oscars. A ceux qui
l’accusaient de n’accepter que des rôles de servantes, et de véhiculer
des clichés sudistes, Hattie McDaniel répondait qu’elle préférait être
payée à jouer les bonniches plutôt que d’en être une. Et on revenait de
loin en la matière.
Dès 1919, on a l’œuvre d’Oscar Micheaux, réalisateur,
acteur, producteur et scénariste, qui déconstruit tous les clichés
racistes véhiculés dans la société américaine ( within our gates, the symbol of the Ku Klux Klan).
Quatre ans auparavant, et c’est l’œuvre retenue, il y a le «naissance
d’une nation», de D.W. Griffith, qui encense les tueurs aux chapeaux
pointus. Rappelons-le, aux débuts du cinéma, il n’est même pas question
d’embaucher des acteurs à la peau noire. Ce sont des blancs grimmés qui
tiennent les rôles. Du black face, comme on dit aujourd’hui, soit l’une
des formes les plus scandaleuses du racisme, puisqu’il participe à la
négation de l’autre.
Dans les deux cas, Naissance d’une nation comme Autant en emporte le vent,
la guerre de sécession est en toile de fond. Les États-Unis ont produit
nombre de séries et de films pour héroïser cette période sans jamais
exorciser cette fracture sociétale. Les films peuvent nous montrer le
chemin parcouru. Mais ce ne sont pas des films vieux de 80 ans qui
construisent la société d’aujourd’hui. Autant en emporte le Vent est
un film de 1939 écrit par une femme sudiste. Mais nous sommes 81 ans
plus tard. Entre temps, il y a quelques films, quelques livres, quelques
avancées de l’histoire. On doit être capable de regarder une œuvre en
la resituant dans son contexte. Fin de citation.
Concernant la Guerre de Sécession - the Civil War pour les Etats-Uniens - vous pouvez lire trois articles ici-même dans la rubrique "Histoire d'ailleurs"
I. 12 AVRIL 1861 : La guerre de Sécession commence…
II. GUERRE DE SECESSION et REVOLUTION
III. GUERRE DE SÉCESSION : WILLIAM T. SHERMAN
|
publié le 17 févr. 2020, 02:57 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 14 mai 2020, 06:07
]
"LA RÉVOLTE DE SPARTACUS, CETTE RAGE, CETTE COLÈRE, C'EST SA VIE"
Le premier film que j’ai vu de Kirk, c'est "20 000 Lieues sous les mers". Dans sa longue filmographie, mes préférés... "La Caravane de feu", de Burt Kennedy en 1967. À ses côtés, au générique, il y a John Wayne. De là date leur amitié, une amitié qui a duré même s'ils n'étaient d'accord sur rien. Avec "Règlements de comptes à OK Corral", Reglements de compte à OK Corral : Burt Lancaster et Kirk Douglas (1957) ce sont là ses deux meilleurs westerns. Au-dessus de tout, je mets "les Sentiers de la gloire"et "Spartacus", tous deux réalisés par Stanley Kubrick. Pour la symbolique qui en dit long sur son engagement de citoyen, d'homme en colère, sa vision claire, positive, vigoureuse et généreuse du monde. C'est magnifique. Dans l'un, il rend justice aux soldats envoyés à la boucherie de 14-18. Quant à "Spartacus", c'est la symbolique absolue pour Kirk Douglas: il venait du prolétariat, et la révolte de Spartacus, cette rage, cette colère, c'est sa vie. En mettant au générique de "Spartacus" Dalton Trumbo [1], c'est une bravade vis-à-vis d’ Hollywood, un grand geste, le geste d'un homme magnifique. Ça symbolise sa vie et c'est du grand cinéma une rigueur dans le filmage, la mise en scène, son jeu... c'est à tomber. II ne pourrait y avoir que le côté péplum, il va plus loin. Il y a le torse puissant, certes, mais on n'est jamais dans l'emphase. On est dans le souffle de l'homme qui assume son destin et qui refuse la contrainte.
J'adore cet homme-là quand il raconte ses engueulades avec John Wayne ! Il a toujours dit les choses simples, il avait des convictions. Il était fier d'être américain et il espérait l’être jusqu’au bout de sa vie : quand il dit ça, ce n'est pas une diatribe mais une affirmation, à l'image de celle des Pères de la nation. Et, surtout, il agit. Il a des principes et II les vit, tout ça sur un siècle.
Avec sa mort, une page de l'histoire d’ Hollywood se tourne, se referme. C'est le dernier des géants. II est le dernier et, aujourd'hui, tout a changé. Même si on a un Brad Pitt, la distance avec les stars n'est plus la même. La star, c'est la distance. Ce mot est désormais employé dans tous les sens, Jean-Pierre Pernaut est la star des JT, un homme qu'on voit tous les jours, c'est dire... La force de Kirk Douglas, c'est d'être une star par sa manière d'être, par son œuvre, mais aussi pour être resté proche de la vraie vie. C'est une époque révolue. Il a été un acteur de cette période dorée qui n'est plus aujourd'hui. Une page se tourne. C'est beau, un homme comme lui, un homme qui n'a jamais dételé.
paru dans L’HUMANITÉ-DIMANCHE du 13 au 19 février 2020
[1] Trumbo est l'un des Dix d’ Hollywood, qui refusèrent de répondre à la question : "Êtes-vous encore, ou avez-vous été membre du parti communiste ?". Il était inscrit sur la liste noire de Hollywood ce qui lui interdisait de travailler dans le cinéma. Note de votre serviteur JPR. |
publié le 10 févr. 2020, 08:40 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 17 févr. 2020, 06:39
]
A l'occasion de la mort de Kirk Douglas - à 103 ans - ARTE nous propose de revoir et voir (pour les plus jeunes) le célébrissime Gunfight at the O.K. Corral, film de John Sturges. Seule la négligence de ma part a fait que ce film ne figure pas déjà sur mon site : c'est un chef-d’œuvre que j'ai vu et revu. J'en parle ici sans l'avoir visionné et ce sont donc mes souvenirs qui vont le faire ressusciter. Allez sur youtube et programmer "musique de OK Corral" : immédiatement vous prolongerez les premières notes. L'apport historique est faible mais existe : c'est incontestablement la page d'une histoire du Far West.
Le scénario est librement inspiré de la célèbre bataille qui éclata le 26 octobre 1881 à Tombstone dans l'Arizona. Il y eut trois morts et cette bagarre -qui impliqua la police locale- eut un retentissement régional (dans l'Ouest des Etats-Unis) et historique : avant de mourir, en 1929 à 80 ans, Wyatt Earp fut interviewé par un journaliste. Cette dernière rencontre donna lieu à un livre publié en 1931, "Wyatt Earp, Frontier Marshall" puis le cinéma s’empara de ce qui est devenu une légende.
<= (Reproduction d'un article relatant l'évènement, Wiki).
Je me dois, d'abord, de citer ma source principale : le livre encyclopédique de Jean-Louis Rieupeyrout , "Histoire du Far West" [1]. Cet auteur n'est pas tendre avec Wyatt Earp et parle du livre de 1931 "comme le recueil le plus complet des mensonges de Earp et source unique mais déterminante de sa mythologie".
Il est sans doute utile de préciser la méthode Rieupeyrout.
"En toute ville du vieil Ouest, écrit-il, existait un quartier géographiquement délimité, celui des plaisirs et du vice, des jeux et de la joie tarifée : le Red Light District encore appelé Hell's Haif-Acre (le « demi-arpent de l'Enfer »). En certaines localités comme les cowtowns [2], par exemple, la ligne de séparation entre ce block et la ville honnête portait le nom évocateur de Deadline (la «ligne de mort »)."
Généralement, cette ligne marque la limite entre la ville où le port des armes à feu est interdit et le ghetto où advienne que pourra. Rieupeyrout classe alors les personnages qu'il présente selon qu'ils sont au-delà de cette ligne rouge et qui sont "Wanted dead or alive!" ou bien s'ils sont "à cheval sur la Deadline" ou encore, troisième et dernière possibilité, ceux qui sont en-deça et qui sont l'incarnation parfaite de la loi. Selon notre auteur, Wyatt Earp relève de la seconde catégorie car il était à la fois membre des forces de l'ordre et tenancier d'un tripot. L'un de ses frères, James, était barman cependant que son épouse tenait un bordel. Dans le film, Burt Lancaster- son personnage en tout cas - est à classer dans la troisième catégorie : il est l'ordre et le droit. Son compère Kirk Douglas est de la deuxième : border line !
Le thème de la "Deadline" est omniprésent dans le film, on a même droit à la reproduction d'un écriteau qui mentionne "Déposez vos armes" autrement si l'on franchit la ligne avec ses armes, on tombera sous le coup de la loi du sheriff. Le règlement de compte aura lieu entre la famille Clanton qui veut passer à travers la ville avec ses armes et son bétail - volé au Mexique ! - et la famille Earp, gardienne de l'ordre.
On a droit aussi à une bonne restitution de la vie économique de l'Arizona et de l’Ouest en général, avec la mise en mouvement de troupeaux généreux et meuglant qui arrivaient dans les cowtowns avec leurs hordes de cow-boys qui n'étaient là que pour quelques jours, de passage, et qui se moquaient bien des droits et us locaux. Une séquence forte nous donne à voir les dégâts causés par ces voyous - Rieupeyrout nous dit que "cow-boy" est un synonyme - dans les locaux de ce qui devait être une fête du village et l'incroyable placidité du Shériff qui arrive, seul, sans arme, dans la salle où il obtient le silence. Seul des acteurs de la carrure de Burt Lancaster peuvent donner du crédit à des scènes pareilles. C'est justement pour ces moments de passage que furent créés ces quartiers mal famés, véritables ghettos où tout pouvait se produire et que l'on isolait par la Deadline. Et Kirk Douglas ? lui aussi est un immense acteur. Il joue le rôle du docteur Holliday, un médecin déchu, atteint d'une tuberculose incurable - et l'on souffre avec lui quand il est pris d'une quinte de toux - atteint d'une autre maladie incurable : le jeu. Le jeu source de tous les conflits, pouvant provoquer la mort et que, pour cette raison on confine au-delà de la Deadline. Doc Holliday, qui gagne toujours, a une mauvaise réputation : il a tué, en légitime défense dit-on mais ce gagneur qui vous prend tout votre argent est-il vraiment blanc comme neige ? c'est impossible. On voudra le lyncher après qu'il a tué un cow-boy venu pour se venger de la mort de son frère mais Wyatt le sauvera et une amitié va naître qui est la colonne vertébrale du scénario. Le Doc a une relation avec Kate, une prostituée, - admirablement interprétée par Jo Van Fleet qui lui prête son visage ravagé - délabrée, défaite, alcoolique comme son partenaire. Leur relation est chaotique qui peut passer de l'amour à l'envie de meurtre, Doc lui dit cruellement "tu incarnes tout ce que je déteste en moi"... à quoi Kate avait déjà répliqué "tu ne vaux guère mieux que moi". La liaison passagère qu'elle va avoir avec Ringo, simple cowboy qui se vend au clan Clanton, sera insupportée par Doc Holliday : ils se retrouveront face à face dans le corral [3]... Au final, ce couple formé par le Doc et Kate marque la présence permanente de la Deadline dans l'histoire.
Cette photo est emblématique du film. Dans la scène évoquée plus haut où le Shérif affronte la bande armée et alcoolisée, Doc Holliday arrive par la porte arrière du saloon. Avec son arme, il tient en respect les cow-boys puis vient se poser face aux malfaiteurs et donne un revolver à Wyatt Earp. Les deux hommes sont, dès lors, invincibles. C'est une amitié virile, aucune embrassade, ni la moindre tape dans le dos. Mais une estime réciproque de la "classe" du partenaire. La veille du règlement de compte, le Shérif vient chercher le Doc pour lui demander son aide : les Clanton seront 6 et les Earp 3 seulement. Malheureusement, Doc Holliday est au fond de son lit, cloué par une crise paroxysmique. C'est la catastrophe. Le matin se lève, la tension est admirablement rendue, c'est un sommet du western. Rassemblant toutes ses forces, Doc se prépare, quitte à mourir "pour le seul ami qu'il a jamais eu". C'est prodigieux. Il va retrouver Wyatt Earp dans sa chambre, on échange les regards, pas un mot, rien. On s'est compris : c'est l'heure. On a alors la célébrissime marche au pas des protagonistes qui vont affronter l’ennemi, la rue est déserte, there will be blood...
A droite du Shériff : doc Holliday, à sa gauche ses deux frères (Virgil et Morgan), le cadet Jimmy Earp a été tué dans l’exercice de ses fonctions par la bande à Clanton, la veille.
On notera que le réalisateur J. Sturges a à cœur de ne pas exploiter cette tuerie. Au matin, lorsque on part pour le gunfight, celle qui devait être la femme du Shériff -et qui l'a quitté parce que cette vie de revolvers ne lui convient pas du tout - Laura, se recueille et, dans un plan séquence bref mais percutant, on voit M'am Clanton se prendre le ventre tordu par l'angoisse de la mère qui voit partir sa progéniture.
En conclusion, très grand film aujourd’hui parfaitement restauré, qui donne à voir deux géants d’ Hollywood que l'on regarde toujours avec une nostalgie infinie.
[1] publié par Claude Tchou, éditeur à Paris, 1970, 720 pages. Les pages 634 à 650 sont consacrées à la famille Earp et à la fusillade de Tombstone.
[2] mot à mot : ville-vaches : bourgade-marché où le bétail arrivait par les pistes avant d'être chargé dans les wagons à bestiaux.
[3] le corral est un enclos destiné au bétail ; dans le cas présent il est comme intégré à la ville. Quant à OK il s'agit sans doute d'un moyen d'identification.
|
publié le 15 juin 2019, 01:49 par Jean-Pierre Rissoan
Publié le 21 juil. 2011 à 16:43 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 3 avr. 2019 à 13:39
]
juillet 2011.
Film
de Michael Curtiz de 1936[1].
Je
rappelle que la charge de la brigade légère est un fait militaire authentique
qui eut lieu lors de la guerre de Crimée (1854-1855) menée par les Anglais et les
Français, contre les Russes. Dans la vallée de Balaklava, 600 lanciers de sa
gracieuse majesté chargèrent des batteries de canons russes, les canonniers
russes étant eux-mêmes secondés par une division de cavalerie. Ce fut un
massacre, un désastre, une des pires fautes de commandement commises au sein de
l’armée britannique.
Concernant
ce film de Curtiz le titre est parfaitement trompeur et le scénario ridicule.
On
arrive à Balaklava exactement 1 heure et 27 minutes après le début du film qui
dure 1h 50. Le film se passe en Russie durant les 20 dernières minutes. Et
auparavant ? Auparavant tout se déroule dans l’empire des Indes. C’est un
film sur l’empire anglais des Indes.
On
sait que les Anglais auront toujours maille à partir avec les Indiens, ce sont
des occupants qui mirent en place un système fiscal ingénieux tel que les
recettes recouvraient entièrement les charges d’administration de l’empire et
que les Anglais purent donc exploiter leur colonie gratuitement. Mais, bien
entendu, le film les présente comme cherchant avant tout la paix, même à ne pas
riposter à une agression armée, la guerre ne peut venir que des Indiens
belliqueux. Le héros, capitaine Geoffrey Vickers (Errol Flynn), a su se faire
aimer des enfants indigènes. Bref que du bonheur, comme nous l’offre la scène
du bal où l’on voit que les Anglais sont vraiment chez eux à …Calcutta.
Dans
ce film sur la guerre de Crimée -si l’on en croit le titre - on a droit à une
chasse au léopard à dos d’éléphant, dans la jungle indienne. On a droit à un
conflit amoureux entre Elsa (l’immortelle Olivia de Havilland) et les deux
frères Vickers, Geoffrey et Perry. Elsa s’était fiancée à Geoffrey, mais, loin
des yeux loin du cœur, durant la longue absence de Geoffrey elle tombe
amoureuse de Perry. Au retour de Geoffrey, elle retombe dans ses bras.
Lorsqu’elle part avec son colonel de père et Geoffrey à la forteresse de
Chukoti, elle fugue et retourne vers Perry qui, lui, avait été envoyé en
mission à Lohara par l’état-major. Car, figurez-vous, l’état-major préfère la
liaison Elsa-Geoffrey à l’autre. A Lohara, Elsa redit son amour à Perry :
bref, c’est une chipie. Où est la puritaine Angleterre ? et la puritaine
Amérique qui a, paraît-il, horreur du mensonge ?
Mais
le plus clair du film est la bataille de Chukoti. Elle résulte de la trahison
-du point de vue anglais- de l’émir Surat Khan qui se soulève contre les
Anglais. Casting et maquillage font tout pour que cet émir passe pour un
vicieux, un retors, un filou, bref, rien de comparable au capitaine Geoffrey
Vickers, au visage frais, glabre et fin, au regard limpide, le vrai WASP
incarné par le sémillant Errol Flynn. C’est l’Orient du mensonge face à
l’Occident lumineux. La garnison du fort Chukoti est cernée, l’émir donne sa
promesse de laisser partir femmes, enfants, vieillards, et -comme de juste- il
ne l’a respecte pas : c’est un massacre ignominieux. Les derniers soldats
restés dans le fort, sentant leur mort prochaine, écoutent le colonel Campbell
leur lire des passages de la Bible. On le retrouvera mort, ses doigts crispés
sur le livre sacré.
La
machine hollywoodienne
Les
Américains ne manquent pas d’air. Toute leur histoire est faite du non respect
de leurs engagements. Histoire qui commence en Angleterre et d’ailleurs le film
traite des Anglais aux Indes.
Quelques
exemples pris dans le tapuscrit de mon prochain livre.
En
Irlande, guerre de 1579-1584, une petite armée espagnole et vaticane - 800
hommes - fut cernée par les canons anglais, elle capitula pour garder –comme
les Anglais lui avaient promis- la vie sauve et tout son effectif fut égorgé
jusqu’au dernier.
Après
le soulèvement des catholiques, toujours en Irlande, Guillaume d’Orange
triomphe. Comme ses prédécesseurs, il signe un traité (Limerick, 1691), traité
« qui sauvegarde encore tout ce qui
peut l’être » mais qui, dès 1695, « n’est plus bon que pour la corbeille à papier » (Cheviré). Et les Irlandais de
subir les Lois pénales : « The penal
laws against the Roman Catholics, both in England and Ireland, were the
immediate consequence of the revolution (…) »[2] c’est-à-dire qu’un Irlandais catholique n’a
plus d’existence légale.
En Écosse, après le soulèvement de 1745, les prisonniers dont certains s'étaient
rendus sous promesse d'amnistie, furent déportés en masse aux Antilles et en
Amérique, comme des esclaves « entassés
dans d'infectes sentines, sans air pour respirer, sans espace pour se coucher
ou se mouvoir ».
En
Amérique, en 1774, des colons ne songent qu’à aller toujours plus vers l’Ouest
et à s’emparer, par la loi de la force, des terres des natives. Des pionniers s’invitèrent dans un village Mingo,
saoulèrent les Indiens avant de les massacrer et de les scalper. Ils mutilèrent
aussi la sœur du chef Logan, laquelle était enceinte. Ces crimes eurent un
grand retentissement. C’est une nouvelle guerre qui débuta. Finalement, Lord John
Murray Dunmore, gouverneur de Virginie, aida les colons de Pennsylvanie à la
répression : sept villages Mingos sont détruits.
A
la veille de la bataille de Yorktown, « plus de 700 nègres infectés par la variole ont descendu le cours de la
rivière. Je compte les renvoyer dans les plantations des rebelles »
écrit le général A. Leslie à Cornwallis, généralissime. Les Britanniques
n’avaient pas respecté leur promesse de libération des esclaves, lesquels
avaient pourtant compté sur la sincérité des Anglais, et devaient maintenant
retourner chez leurs maîtres.
A.
de Tocqueville écrit :"Les Européens
ont condamné les tribus indiennes à une vie errante et vagabonde, pleine
d’inexprimables misères. Je crois que la race indienne est condamnée à périr,
et je ne puis m’empêcher de penser que le jour où les Européens se seront
établis sur les bords de l’océan Pacifique, elle aura cessé d’exister " Pourquoi vagabonde ? Parce que les
Européens, comme dit Tocqueville - en réalité, les Américains - ne respectent
jamais leurs accords. On signe un « traité »
qui prévoit une nouvelle "frontière"
puis quand le nombre de pionniers est de nouveau élevé, on demande aux Indiens
de déguerpir ou l’on crée les conditions pour qu’ils le fassent, et ainsi de
suite. Il existe ainsi des dizaines de traités dans les archives. Tous non
respectés. Un chef indien vaincu dit à ses ennemis : "Vous savez
les raisons pour lesquelles nous vous avons fait la guerre. Tous les hommes
blancs le savent et ils devraient en avoir honte. (…). Un indien qui serait
aussi mauvais que les hommes blancs ne pourrait pas vivre parmi nous".
Il
y a comme ça bien d’autres méfaits. Ce film de Curtiz et de la Warner Bros. est
une immense mystification, un énorme mensonge de propagande. Comment
l’expliquer ? est-ce que la montée des tensions en Europe (1936) a poussé
les Américains à rappeler la qualité de leurs cousins d’Angleterre et qu’il
faudra peut-être, un jour, voler à leur secours ? je ne sais.
Et
la charge ?
Comment
passe-t-on de Calcutta à Sébastopol ? Les scénaristes ont plus d’un tour
dans leur sac. Surat Khan fuit l’Inde où il se sait traqué et rejoint ses
alliés russes dont il avait appris qu’ils allaient combattre l’Angleterre. Il
est donc logiquement à Sébastopol ! Apprenant cela, le 27° lanciers et son
major Geoffrey Vickers n’ont qu’un désir : se venger du massacre de
Chukoti.
Mais
le supérieur hiérarchique de Vickers, Sir Macefield, ne veut pas lancer sa
brigade contre les canons russes et dicte à Vickers une lettre ordonnant le
retrait de la cavalerie. Vickers est stupéfait et alors - chose
invraisemblable- commet un faux en écriture, il rédige une nouvelle lettre
ordonnant l’assaut qu’il signe Macefield !
et cette charge de cavalerie de la guerre de Crimée s’explique ainsi par le
désir de Vickers et de ses camarades de tuer Surat Khan. Quelle histoire !
Bref,
ce film n’a guère d’intérêt. Il rappelle leur enfance à des gens de ma
génération, enfance qui fut encadrée par la propagande des films américains
mais la charge est un moment inoubliable. La mise en scène est parfaite, il
faut le dire. Les lanciers mènent d’abord leur monture au pas, puis on passe au
trot, progressivement on passe au galop jusqu’à la sonnerie de trompette qui
annonce la charge menée au grand galop. La musique nous casse les oreilles mais
on l’accepte comme élément du décor. Les canons russes crachent le feu, les
chevaux s’effondrent. L’union jack va tomber par terre. Non ! un autre
lancier est là pour le reprendre des mains du mourant. Les Anglais meurent.
Pour quoi ? pour qui ? peu importe, ils meurent en gentlemen.
N’est-ce pas l’essentiel. C’est un désastre mais Surat Khan subit le martyr de
saint Sébastien : chaque lancier qui a réussi à sauter pas dessus les
batteries russes -il y en eut quelques uns tout de même- lui plante sa lance dans le corps. Vickers peut alors rendre
son âme à Dieu.
Le poème déroulèdien d’Alfred Lord Tennyson The Charge of the Light Brigade est ici omniprésent. Et le film nous invite à rendre hommage à ceux qui ont tué Surat
Khan…
Le
film de Tony Richardson La charge de la brigade légère (1968) est d’une tout autre facture.
|
|
publié le 15 juin 2019, 01:36 par Jean-Pierre Rissoan
publié le 8 mai 2012 à 12:20 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 31 janv. 2019 à 16:43
]
L’Institut Lumière de Lyon
a programmé pour la période d’avril-mai 2012, La
captive aux yeux clairs (The Big Sky) de Howard Hawks.
Il présente le film de la
manière suivante : « la fille d’un chef indien provoque la rivalité
entre deux amis aventuriers … Un chef-d’œuvre de Hawks, d’une simplicité et
d’une beauté admirables, un grand film sur l’amitié masculine et le
désir. ».
C’est d’abord selon moi un
beau western, au sens premier c’est-à-dire un film qui a pour cadre le Far
West, « l’extrême-occident » comme on ne dit pas [1].
Sans tout dévoiler, disons que le scénario raconte les aventures d’un pionnier
qui, sur son bateau le Mandan,
remonte à partir de St-Louis, l’affluent du Mississippi, le Missouri. L’action
se déroule en 1832. Le pionnier s’appelle Jourdonnais, nom à connotation
française mais n’est-ce-pas le cas de Saint-Louis également ? Le cadre
géographique choisi est celui de l’ancienne Louisiane française qui intégrait
tout le bassin-versant du Missouri-Mississippi jusqu’au haut des Montagnes Rocheuses.
Louisiane vendue pour une bouchée de pain par Bonaparte. Jourdonnais parle
français dans le film original.
Il fallait à Jourdonnais
un équipage. Le trappeur Deakins (Kirk Douglas) et son nouveau copain Boone
Caudill fuient les prisons de St-Louis et partent à l’aventure qui leur est
proposée par l‘oncle de Boone, un vieil aventurier qui, lui, a tout connu.
Tout cela renvoie à l’analyse que fait H. Arendt sur la nature sociale de ceux qui
ont conquis l’Amérique. Mais, ici, nos deux protagonistes sont de bons bougres.
Les aléas du voyage font que l’on découvre à bord du bateau la présence d’une
femme - épreuve redoutable pour le capitaine Jourdonnais qui voulait dissimuler
sa présence, sachant bien que dans cet univers masculin clos cette présence
ouvrira une compétition qui peut être fatale à son expédition. Cette femme est
une indienne, aux yeux bleus -d’où le titre français du film- belle et
mystérieuse. L’amitié de Daekins et Caudill est exposée à ce risque car on se
doute que nos deux stars hollywoodiennes ne vont pas être insensibles aux
charmes de Teal Eye (Yeux bleus).
Film d’aventure, La captive aux yeux clairs raconte la
remontée du Missouri. Jourdonnais veut
commercer avec une tribu indienne des Rocheuses, tribu de chasseurs qui vendent
des peaux de bête recherchées. Si l’expédition réussie, la fortune à vie est
assurée non seulement pour Jourdonnais mais pour tout l’équipage. H. Hawks
reprend le célébrissime scénario du roman de Joseph Conrad Heart of Darkness, titre original du roman « Au cœur des ténèbres ».
Nul n’ignore plus que ce scénario a fourni la trame à Apocalypse Now. Mais, historiquement, il semble bien que ce
soit Hawks et son scénariste qui ont eu les premiers l’idée de porter à l’écran
cette trouvaille [2]. Un autre film utilise les
mêmes ressorts dramatiques : Aguirre ou la colère de Dieu. Mais dans ce
cas, le radeau descend le fleuve amazonien pour aller aux devants de multiples
dangers au lieu de le remonter comme dans le roman africain de Conrad.
Donc tout y passe et l’atmosphère dramatique est à
chaque fois bien rendue : au fur et à mesure que le Mandan
progresse les ennuis se multiplient. Remonter un fleuve de montagne c’est
forcément rencontrer des rapides tumultueux et le bateau s’échoue sur la rive,
c’est rencontrer des Indiens hostiles - les Crows- qui se cachent derrière les
arbres et courent aussi vite que le bateau qui peine à vaincre le courant
contraire. Ces Indiens sont hostiles car ils sont, en réalité, stipendiés par
une compagnie opposée à l’expédition de Jourdonnais. La Compagnie des
Fourrures va tout entreprendre pour faire échouer l’entreprise. Et comme
elle est constituée de bandits, on imagine ses méthodes. Mais encore une fois,
la conquête de l’Ouest américain ne fut pas le fait de braves gens munis de
leur seule Bible. Donc le bateau progresse lentement à travers moult
difficultés haletantes et, enfin, il arrive à son Eden, son paradis, son
Canaan. Fortune sera faite (et fête aussi, bien sûr).
Je n’évoque pas la fin du film sur le qui des deux
héros aura l’amour de la belle indienne. Laissons le suspense à ceux qui n’ont
pas vu le film.
Les Yankees ont
pris très au sérieux la « quête du
bonheur ». Avec La captive aux yeux clairs nous avons sous les yeux une version soft de cette quête : L’action se
déroule dans les années 1840’. Les luttes décisives contre les Indiens des
Grandes Plaines sont encore loin. Le capitaine Jourdonnais réussit dans son
entreprise d’aller chercher peaux et fourrures chez les Indiens Pieds-Noirs de
la haute vallée du Missouri. Il en revient très riche, lui et tout l’équipage [3]. « Oui,
mais vous aussi. Tout le monde est riche » dit-il. Que feras-tu
de cet argent lui demande-t-on. « Ah !
Ça…Je n’avais jamais pensé que je serais riche. Et voilà ! J’achèterai une
maison à ma femme. Les aventures, c’est fini, je reste à la maison avec ma
femme. Puis, j’achèterai des habits pour elle et pour moi. Et je me promènerai
dans la rue, en fumant un gros cigare. Tout le monde saura que je suis riche.
Et on dira « ah ! Mr Jourdonnais, comment allez-vous ? Très
bien, mon vieux, merci ». Je leur offrirai un cigare. Peut-être… Mon
bonheur est là ».
Ce
film dont la réputation n’est plus à faire retrace l’esprit pionnier : Plus
on pénètre les Rocheuses plus les dangers se multiplient. Mais on n’a rien sans
rien. Et, au bout des efforts et sacrifices, on obtient le bonheur. Au fond, ce
film est la présentation concrète de l’idéologie de la quête du bonheur.
Et pour le brave Jourdonnais,
le bonheur c’est l’argent.
P.S. Le film est une commande de Howard Hughes, le
directeur de la RKO, troisième studio américain qui se trouve alors en
difficulté. Le producteur veut réitérer la réussite de La Rivière rouge
avec une nouveau fait historique de la conquête de l'ouest porté pour la
première fois à l'écran. Si le film démarre très bien dans les salles, la RKO décide
soudain d'en couper douze minutes pour pouvoir placer plus de séances. Une
décision qui entraîne une défection du public et fait de The Big Sky un
nouvel échec commercial qui précipite le déclin du studio. Source : encyclopédie
Wikipaedia.
Moralité :
la recherche effrénée du profit peut donc nuire au bonheur
[1]
Alors que l’usage a accepté Far-East et Extrême-Orient.
[2]
Le scénario s’appuie sur le roman « Teal eye » (1947) de A.B. Guthrie
qui connaissait certainement l’œuvre de Conrad.
[3]
N.B. : les dialogues qui suivent sont la retranscription exacte - effectuée par mes soins- de scènes
de la version longue du film.
|
|
publié le 15 juin 2019, 01:26 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 4 nov. 2019, 13:02
]
publié le 25 juil. 2012 à 18:05 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 30 oct. 2017 à 14:17
]
L’Institut Lumière
de Lyon programme Lawrence d’Arabie
pour la rentrée. Sur écran géant, le film qui se déroule pour l’essentiel dans
le désert donnera toute sa mesure. Les auteurs nous offrent avec raison des
plans prolongés sur la géomorphologie d’un pays aride mais aussi sur le ciel de
la nuit ou encore les levers de soleil et le terrible zénith où l’on ne peut pas
dire autre chose que le soleil écrase tout.

Je parle de "Moyen
Age" : c’est l’expression utilisée par l’auteur de l’article "Arabie
saoudite" de l’ Encyclopaedia Universalis (1975), "introduire des changements dans une société
figée à l’heure du Moyen Age". Et à quoi ressemble l’Arabie des
bédouins au Moyen Age ?
« La vie au Bédouin
est pauvre, sa nourriture insuffisante, ses biens matériels peu nombreux. Il
meurt souvent de faim au sens littéral des mots. On comprend dès lors qu'il ait
souvent recours au brigandage. Les razzias entre clans sont la règle el n'ont
rien de déshonorant.  « La société bédouine
est fragmentée en multiples sociétés économiques qu'on appelle des clans ou des
sous-tribus. Les tribus sont des groupes de clans, plus ou moins artificiels,
dont les relations étroites sont exprimées par des généalogies fictives.
Parfois une tribu parvient à imposer sa suprématie à d'autres, mais en général
de façon peu durable les vrais États de l'Arabie déserte ont été, le plus
souvent, imposés de l'extérieur. Ainsi le royaume de Kinda protégé par les
Sudarabiques. Des clans et des individus s'enrichissent par la razzia, le
commerce, le prélèvement de prestations sur commerçants et agriculteurs,
parfois sur d'autres nomades. Ils ont pu réduire des captifs en esclavage ou
acheter des esclaves.
Mais les conditions de la vie arabe se prêtent mal à
l'assujettissement permanent d’une classe. Les affranchissements étaient
fréquents, laissant subsister un lien de « clientèle »[1].
Le film donne à voir cette
lutte des tribus entre elles, notamment entre les Harith et les Howeltat, cette
dernière étant dirigée par Auda Abu Tayl (interprété par Antony Quinn,
magistral comme toujours) qui contribuera à la création du royaume indépendant
- mais éphémère- du Hedjaz [2]. La
séance finale qui rend compte de la tenue du Conseil national arabe, dans Damas conquise sur les Turcs, est
(involontairement ?) cocasse, avec des chefs qui montent sur les tables
pour aller attraper celui qui dit le contraire de ce qu’il vient de dire. Avec un
héritage pareil et le respect du traditionalisme religieux le plus
fondamentaliste, on comprend que la démocratie soit difficile à mettre en
place…
Le film est un film de
guerre : il s’agit du front d’Asie occidentale[3]
de la 1ère guerre mondiale qui voit s’opposer les Anglais présents en Égypte et les Turcs alliés des
Allemands qui possèdent -juridiquement- alors toute la péninsule
arabique : c’est l’empire ottoman. En 1916, le 5 juin, Hussein ben Ali,
chérif de La Mecque, famille des hachémites, de la tribu des Harith,
se dresse contre les Turcs qui méprisaient et maltraitaient les Arabes. Ce
faisant, il devient l’allié objectif des Anglais. La lutte armée est menée par
son fils, l’émir
Fayçal (1883-1933). Mais le film est centré sur l’action de Lawrence qui
connaît bien la région pour y avoir travaillé avant la guerre, qui pratique la
langue arabe et qui est chargé de tenter une coordination entre ce qui doit
devenir une alliance en bonne et due forme. Lawrence est vite partagé entre son
devoir de sujet de sa Majesté et son attirance pour le désert et ceux qui y
vivent. Au point qu’il revêt le vêtement arabe, blanc brodé d’or -et le blond
Peter O’Toole avec ses yeux bleus fascinants y est comme un lion superbe et
généreux-. C’est d’ailleurs lui qui préside la séance du Conseil national arabe…
 La fin de la 1ère
partie du film (qui dure 3h 30mn..) est dominée par la prise du port d’ Aqaba.
Fait d’armes authentique. Aqaba est un port de la Mer Rouge (au fond de
l’antenne d’escargot droite) qui donne accès à ce qui est aujourd’hui port -et
le seul- de la Jordanie, voie de ravitaillement importante. Les Turcs l’ont
fortifié et équipé de batteries de canons lourds. La marine anglaise ne peut y
accoster. Côté terre, Aqaba a pour arrière-pays un hyper-désert,
infranchissable, un four. A tel point que les Turcs n’ont rien aménagé,
estimant impossible un assaut par voie de terre. Les canons sont fixes et ne
peuvent être retournés. Lawrence, homme qui écrit son destin, réussit à
convaincre le chérif de Fayçal (Omar Sharif, magnifique et expressif dans ses
doutes qui naissent en lui lorsqu’il s’éveille à la politique) et Auda Abu Tayl
à tenter l’exploit. Il l’entreprend sans en référer à ses supérieurs et en
tenue d’émir. Et il réussit ! Son aura devient dès lors immense chez les bédouins.
D’autant que tous les ravitaillements que les Anglais vont fournir passent par
lui et, pour les Arabes, c’est Lawrence qui les donne, c’est une corne
d’abondance mieux, la Providence.
« Je me bats comme Clausewitz et vous comme
Saxe… ! »
Dans ce film hollywoodien
destiné au grand public, ne voilà-t-il pas un dialogue de (très) haute
tenue ? C’est assez rare pour être souligné. Clausewitz est un officier
allemand qui combattit Napoléon Ier. Il a écrit un célébrissime « De la guerre… » et l’on connaît son
adage « La guerre n'est qu'un prolongement de la
politique par d'autres moyens ». Maurice de Saxe, maréchal de France, a écrit dans les années 1730, un
ouvrage sur la guerre et la tactique, qu’il intitule bizarrement Mes
Rêveries. En substance, là où Clausewitz préconise une guerre totale visant
l’ennemi au cœur avec le maximum de moyens, Saxe pense qu’il est possible de
manœuvrer, de louvoyer, il écrit : «Je ne suis
cependant point pour les batailles, surtout au commencement d’une
guerre, et je suis persuadé qu’un habile général peut la faire toute sa vie
sans s’y voir obligé». C’est le
général Allenby qui se bat comme Clausewitz, concentrant ses tirs d’artillerie
sur des cités stratégiques, etc... Alors que Lawrence est l’instigateur,
nécessité oblige, d’une guerre de guérilla.
Avec ses bédouins, courageux mais démunis face à l’armée turque formée à
l’allemande et équipée, il ne peut entreprendre des batailles rangées, sauf en
automne 1918. Il harcèle, il sabote, coupe les voies de ravitaillement et ainsi
de suite. Son ingéniosité est telle qu’il ne détruit pas la voie ferrée Médine
- Damas. Il faut que les Turcs, malgré les attentats dont elle est l’objet, y
voient encore quelque utilité. Il s’en explique :
"….
Considérant les milliers de Turcs
enfermés à Médine, mangeant les chameaux qui auraient dû les porter à La Mecque
et qu’ils étaient incapables d’emmener paître alentour, Lawrence pousse la
réflexion jusqu’à son terme : « Là (à
Médine, JPR), immobiles, (les Turcs) étaient inoffensifs ; faits prisonniers, il faudrait les nourrir et les garder en Égypte ; repoussés vers le nord en Syrie, ils rejoindraient le gros de leurs forces
qui bloquaient les Britanniques dans le Sinaï. À tout point de vue, ils étaient
mieux là où ils étaient, et de plus, ils attachaient du prix à Médine et
tenaient à la conserver. Qu’ils la conservent ! »[4]
C’est
là un bel exemple de non-guerre qui neutralise des milliers d’ennemis.
La lutte finale
La
carte ci-jointe montre la participation de Lawrence et de ses colonnes de
bédouins à l’assaut final sur Damas. A l’ouest, Allenby longe ce qu’on appelle
aujourd’hui la bande de Gaza, traverse la Palestine puis franchit le Golan pour
déboucher sur Damas. A l’est, l’armée de l’émir Fayçal et les bédouins de
Lawrence traversent la Transjordanie, rive gauche du Jourdain. Le film adopte
la thèse, discutée par les historiens, selon laquelle Lawrence a à cœur
d’arriver à Damas AVANT l’armée anglaise. Il veut que les Arabes d’ Hussein
soient gratifiés de la victoire. Il a, en effet, appris l’existence des accords
Sykes-Picot. De quoi s’agit-il ?
C’est une magouille
internationale, l’aspect le plus crû de la diplomatie secrète. Anglais et
Français envisagent de dépecer l’empire ottoman. On n’a pas fait la 1ère
guerre mondiale parce qu’on était mécontent de l’assassinat de l’archiduc Ferdinand
à Sarajevo ! Ce fut une guerre impérialiste. "On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels"
(Anatole France). Cette zone est névralgique au double point de vue des
transports, avec le canal de Suez visible dans le film, et surtout avec le
pétrole dont le nom, en revanche, n’est jamais prononcé. Les Anglais qui
étaient présents en Égypte mais aussi au Koweït (dès 1899) reniflaient le
pétrole un peu partout avec la Shell au nez fin qui s’unira à la Royal Dutch en
1907. Les Français étaient présents économiquement en Syrie [5].
En secret donc, MM. Sykes et Picot élaborèrent un plan de partage du gâteau
avec les Russes (encore en guerre du côté allié en 1916) et les Italiens. Au
nez et à la barbe des Arabes auxquels on promettait monts et merveilles.
(cartes). Lawrence comprend que tout ce qu’on lui a demandé jusqu’à présent
n’avait pour but que de faire jouer aux Arabes un rôle de supplétifs et
qu’après la domination turque ils auraient la domination anglaise… Pourtant, le Haut Commissaire Britannique d’Égypte, Sir Henri Mac-Mahon avait échangé une correspondance avec Hussein ben Ali.
Tout
cela n’est pas très ragoûtant et si l’on ajoute que les Anglais par la plume de
Lord Balfour ont promis aux Juifs (2 novembre 1917) "l’établissement en Palestine d’un Foyer
National", on est ici aux sources des problèmes du Proche-Orient.
Mais le film ne va pas
jusque là. Les accords Sykes-Picot sont cependant au cœur d’une séquence
intéressante. Il y a là un personnage de fiction, véritable commissaire
politique du gouvernement de Londres, Mr. Dryden, qui parcourt tout le film.
Voici comment Wikipaedia en anglais en dresse le portrait (c’est moi qui
souligne).
Mr. Dryden is a major character in the film Lawrence of Arabia (1962). He is portrayed by veteran actor Claude
Rains. He is a diplomat and political leader, the head of the Arab Bureau, who
first enlists T. E. Lawrence (Peter O'Toole) for work as a liaison to the Arab
Revolt, and manipulates Lawrence and the
Arabs to ensure Allied dominion over
the post-war Middle East. He is an amalgamation of several historical
figures, mainly thought to be the British diplomatic adviser Colonel Sir Mark Sykes and the French diplomat François
Georges-Picot, authors of the
controversial Sykes-Picot Agreement.
Il est temps de conclure. Peter
O’Toole prête sa frêle silhouette à ce personnage d’exception que fut Lawrence
qui finit la guerre au grade de colonel, la poitrine bardée de décorations. Le
film semble aller vers l’hagiographie mais Lawrence est rabaissé brutalement
lorsqu’on le voit couvert de sang - sang et or - parce qu’il s’est vengé d’une
humiliation infligée par le bey turc de Dera’ a. On sait que Lawrence qui est
mort célibataire à 37 ans sans partenaire féminine connue est toujours l’objet
de curiosité plus ou moins saine. Le film passe outre. En 1962, l’Occident a
besoin de héros.Et de l'amitié des Arabes après la piteuse expédition de Suez.
Voir aussi :
- Histoire de la Palestine contemporaine (1ère partie ; avant 1914- 1945) - Le Proche-Orient à l'issue de la première guerre mondiale
- Article Wikipaedia "Partitions de la Palestine"
- compulsory : http://www.jolimai.org/?p=381 :
Lawrence d’Arabie et Clausewitz par T. Derbent
- "Lawrence et le rêve arabe",
brève biographie par Suleiman Mousa, historien jordanien, revue L’Histoire,
n°39, année 1981
[1] E.U. (1975), article "Arabie".
[2]
Lequel sera conquis par Ibn Saoud en 1925, unification qui est à l’origine de
l’Arabie saoudite (1932).
[3]
Sur ce front, luttaient également des Français, des Australiens, des Indiens
côté anglais et des soldats allemands côté turc.
[4]
Cité par T. Derbent (voir les
références en bas de l’article). Je n’ignore pas le caractère schématique de
mon analyse. C’est pourquoi je renvoie le lecteur intéressé à l’intégralité de
l’article de T. Derbent.
[5]
Voir par exemple l’article Wikipaedia "expédition
française en Syrie (1860-1861)" |
|
publié le 15 juin 2019, 01:21 par Jean-Pierre Rissoan
publié le 12 sept. 2012 à 00:37 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 27 sept. 2017 à 20:20
]
Au programme du festival LUMIÈRE de Lyon 2012.
La
Nuit du chasseur est considéré comme
l'un des plus grands films de tous les temps. Beaucoup de choses ont été
écrites sur ce chef-d’œuvre, quelle peut bien être la valeur ajoutée de
l’article que je suis en train d’écrire ?
Ce
film condense toutes les interrogations qu’un progressiste peut avoir à l’égard
du monde anglo-saxon.
Il
est une charge formidable contre l’hypocrisie religieuse d’une large proportion
de protestants d’outre-Manche et d’outre-Atlantique. On sait que l’argent fut
au cœur de la Réforme.
Le
règne de Henri VIII Tudor tout entier se vit qualifier « d’âge du pillage »
et « l’évolution religieuse du pays se doubla, il faut bien l’avouer,
de menées assez sordides en vue d’un enrichissement personnel par le biais des
spoliations religieuses » ; un autre historien affirme que
« la dissolution et la suppression des monastères furent une
manipulation politique et financière déguisée, au début, en réforme religieuse ».
Auparavant, en Allemagne, il en fut de même. Voici l’aveu du roi de Prusse
Frédéric II, lui-même très proche de ses sous : « Si l’on veut réduire les causes du progrès
de la Réforme à des principes simples, on verra qu’en Allemagne, ce fut l’ouvrage
de l’intérêt ». Cette originalité est observée par les contemporains
étrangers ; ainsi la reine Christine de Suède (1654) : « Vous autres Anglais êtes des dissimulateurs
et des hypocrites (…) je crois qu’il y a en Angleterre beaucoup de gens qui
font profession de plus de sainteté qu’ils n’en ont réellement, espérant en
tirer profit ». À quoi Guillaume III d’Orange, Hollandais de naissance
mais nouveau roi d’Angleterre, fera écho quelques temps plus tard (1689) :
« ce pays (…) parle toujours de
religion mais en a certainement moins que vous ne sauriez le croire » (à
l’électrice de Hanovre). "L’argent est ici souverainement estimé, l’honneur et la vertu peu". Ainsi s’exprima Montesquieu,
par ailleurs laudateur des "libertés anglaises".
Les
WASP - white anglo-saxons-protestants - d’Amérique sont les héritiers de cette
tradition. Alexis de Tocqueville parle du « peuple le plus civilisé et j’ajouterai le plus avide du globe ». Le
sénateur Theodore Frelinghuysen
(1787–1862) (New Jersey, Église réformée hollandaise) qui s’opposa à la loi sur
le déplacement des Indiens, 1830, notamment par un discours de plus de six
heures qui est resté célèbre, vitupéra : « notre insatiable avidité de sangsues qui continue de nous faire hurler "Encore !
Encore !
" » .
Étrange
coïncidence, le film, La nuit du chasseur,
est tourné l’année même où la maxime « In
God We Trust » à imprimer sur le dollar-papier est approuvée par un
acte du Congrès. Mais dès 1864, elle figurait sur la pièce de 2 cents.
Religion et argent sont intimement mêlés chez les Anglo-saxons.
Les
jeunes lecteurs qui n’auraient pas vu le film ont compris qu’il y est question
d’argent. Voici d’ailleurs ce qu’en dit Wikipaedia : « Lors d'un court séjour en prison, le pasteur
Harry Powell a comme compagnon de cellule Ben Harper, un homme désespéré qui,
pour sauver sa famille, a commis un hold-up et assassiné deux hommes. Powell
cherche à faire dire à Harper où se trouvent les 10.000 dollars dérobés, mais
celui-ci ne cède pas. Le prêcheur fanatique se rend chez la veuve de Harper,
qui a été pendu. Willa Harper ne tarde pas à épouser l'homme d'Église, ne
voulant pas voir que ce dernier ne désire qu'une chose : faire avouer à
ses enfants, John et Pearl, l'emplacement du magot ».
C’est
en effet un homme d’Église, un pasteur, qui va harceler les deux enfants. C’est
un harcèlement criminel avec menaces de mort, utilisation d’un couteau terrorisant,
etc… Powell a toute une théorie sur ce couteau : il va jusqu’à citer l’Évangile "je ne suis
pas venu apporter la paix, mais l’épée" (Mathieu X-34). Son goût par trop visible pour l’argent avait fait
s’interroger Ben Harper dans sa cellule et il avait demandé au pasteur quelle
était son Église ? Powell répondit avec l’esprit du Malin « je prêche la religion qu’on a échafaudée, le
Tout puissant et moi». Autrement dit, il a créé sa propre Congrégation,
chose non rare chez les adeptes du dogme du sacerdoce universel mis en avant
par Luther. Powell n’a donc que l’Écriture à la bouche, il parle amour mais il ne pense qu’à l’argent. Le
début du film a prévenu le spectateur et donné le la en l’occurrence la parole de Jésus (Mathieu VII-15.20) "Gardez-vous des faux prophètes qui viennent
à vous vêtus en Brebis mais qui en dedans sont des loups".
Le pasteur est un serial killer : sa proie préférée
est la veuve de fraîche date, la veuve désemparée qui peut facilement succomber
à l’écoute de son baratin mielleux. Ce sera le cas de l’épouse de Ben Harper,
Willa, un peu sotte et naïve et qui ne s’aperçoit de rien. On découvre à cette
occasion que le pasteur a de gros problèmes de sexualité. Déjà, une séquence
l’a montré au cinéma visionnant un film exhibant une danseuse court vêtue, ça
le dégoûte, sa colère monte ainsi que la pulsion de mort et la lame de son
couteau qu’il a fait éjecter de son manche perce sa veste. Ayant épousé Willa,
il la repousse méchamment lors de ce qui aurait dû être la nuit de noces :
"pour moi, le mariage unit deux
esprits devant le Ciel !". Willa va dès lors sombrer dans le
mysticisme, elle fera amende honorable devant toute la paroisse, -curieuse
séquence où l’on voit son visage encadré par deux torches aux flammes
virevoltantes, on dirait une séquence de désenvoûtement-. Elle mourra dans son
lit, comme une sainte entourée d’un halo de lumière vive au cœur de la nuit
noire.
Fuyant le monstre, les
deux enfants montent dans une barque et descendent l’Ohio river. La comparaison avec Moïse dans son berceau sur le Nil
est explicite et dite dans les dialogues du film. Le garçon, John Harper, qui tient absolument à respecter la promesse
qu’il a faite à son père de ne pas dévoiler la cachette des 10.000 dollars, est
interprété par Billy Chapin. Merveilleux casting. L’enfant blond est à
l’évidence le WASP qui incarne l’avenir de l’Amérique. Il est White
de race pure - son père géniteur est un grand blond aussi (le rôle est interprété par Peter Graves alors âgé de 27 ans) - il est
courageux, plein d’initiatives… Certes son père a tué mais nous sommes en pleine crise des années 30' et comme dit
Jésus : "On juge
l’arbre a ses fruits" (Mathieu VII-15.21) et ayant engendré un si bon
fils, le père ne pouvait pas avoir mauvais fond. Néanmoins, avant d’assumer sa vie d’adulte, le fils a besoin de la
protection de la brave dame qui a recueilli le John-Moïse dont la barque s’est
échouée sur la berge : Rachel Cooper (définitivement
incarnée par Lillian Gish). L’affrontement entre Mitchum/Powell versus Gish/Cooper est un moment
d’anthologie.
Rachel
est imbibée de l’Écriture sainte comme un buvard. Elle aussi n’a que l’Évangile
à la bouche. Quelle différence avec le pasteur ? Ils disent la même chose.
Mieux, ils chanteront le même chant, l’un dans le jardin attendant sa
proie ; l’autre calfeutrée chez elle, le fusil dans son rocking-chair, comme Ma’ Dalton. La
différence vient du cœur. Rachel élève des enfants abandonnés comme une vraie
mère. Elle sait -elle le dit- qu’elle est utile en ce monde. Mais, en mettant
l’accent sur les œuvres, Laughton ne donne-t-il pas raison aux catholiques
plutôt qu’aux protestants pour qui seule compte la foi ? On ne lui en
voudra pas : mieux vaut de bonnes œuvres que des paroles qui cachent la
soif de remplir son coffre-fort.
La
fin du film montre la populace américaine qui brûle ce qu’elle a adoré. Après
avoir été subjuguée par le pasteur, la voici qu’elle veut le lyncher : It’s a long way to le
royaume de Dieu sur la Terre…
Mais
ce film pose encore une question : cette dénonciation de l’hypocrisie
essentielle à nombre de puritains, hypocrisie qui condamne les États-Unis à ne pas diriger le monde, voici
précisément un film américain réalisé par un Anglais qui se positionne du bon
côté, qui montre la bonté d’une Rachel Cooper. Les États-Unis ne sont-ils pas
le pays de ceux qui savent voir le mal qui est en eux et qui justement sont
aptes à donner l’exemple ?
Pilgrims Fathers et Puritans Fathers
Les États-Unis sont un Janus aux deux visages. D’où vient cette ambivalence ? Faut-il établir une distinction entre les Pilgrims Fathers et les Puritans Fathers ? Je pense que oui.
C’est E. Ryerson [1] qui donne l’explication,
comme par ailleurs l’historien F. Roz[2].
Tout le monde admet qu’il y eut deux colonies très distinctes en Nlle-Angleterre :
la colonie de Plymouth et celle de la Massachusetts Bay (Boston - Salem), qui
vécurent juxtaposées avant que Plymouth ne fût absorbée par Boston.
La colonie de Plymouth fut créée par les Pères
Pèlerins, les Pilgrims Fathers, en
1620. "Pèlerins" parce qu’ils avaient quitté
l’Angleterre pour s’installer en Hollande, pays de la liberté religieuse together with the spirit of commerce
(p.3) avant de partir, après onze ans, pour le Nouveau Monde via une courte
escale à Plymouth. C’est l’épopée bien connue du Mayflower. Une compagnie hollandaise leur avait proposé de
s’installer dans la baie de l’Hudson, site de New Amsterdam, en son nom, mais
les Pèlerins préférèrent demeurer fidèles à la mère-patrie. Ces hommes avaient
appris en Hollande l’esprit de tolérance, ce sont eux qui remercièrent les
Indiens, ils étaient fidèles à la Couronne :
Les
débuts de la colonisation furent, en effet, difficiles et la moitié des
arrivants périrent du scorbut. Les Anglais ne durent leur salut qu'à
l'intervention d’une tribu d’autochtones qui leur offrit de la nourriture, puis
leur apprit à pêcher, chasser et cultiver du maïs. Afin de célébrer leur
première récolte, à l’automne 1621, le gouverneur de la toute jeune colonie,
William Bradford, décréta trois jours d'action de grâce, Three thanksgiving days. Les colons invitèrent alors le chef indien
Massasoit et quatre-vingt dix de ses hommes à venir partager leur repas avec
dindes sauvages et pigeons en guise de remerciement pour l'aide apportée. Comment expliquer ce paradoxe, scandaleux
pour l’esprit, entre ce repas de remerciements fraternel et le génocide qui
commence quelques années plus tard, en 1636, avec le début de la Guerre des Pequots, tribu qui sera quasi exterminée ?
Comment expliquer ce qui apparaît comme une tricherie, une traitrise, une
fourberie, que sais-je ?
"They were honourable and faithful to their treaty engagements with the
aborigines as they were in their communications with the Throne » et Ryerson ajoute quelque chose de très important
pour la suite de l’histoire des Treize colonies :
« it was among the sons and
daughters of the Plymouth colony that almost the only loyalty in New England
during the American revolution was found".
"En 1628, une autre colonie puritaine,
celle du Massachusetts, était fondée à Salem, par John Endicott. (…). Sa capitale, Boston, future métropole de toute
la région, est fondée en 1630"[3]. Mais ces puritains-là ne
sont pas aussi purs que les précédents. Au-delà des péripéties, disons
simplement que les meneurs obtinrent une charte royale pour une compagnie à
vocation commerciale et de prosélytisme religieux qui servit en même temps de
couverture pour l’exil de puritains persécutés - c’est l’époque des premiers
rois Stuart suspects de crypto-catholicisme -.
"It was professedly a religio-commercial undertaking" écrit Ryerson et "the religious aspect of the
enterprise was presented under the idea of connecting and civilizing the
idolatrous and savage Indian tribes of New England".
Ces puritains s’administrèrent rapidement en prenant
de larges libertés avec la mère-patrie. Les membres du conseil d’administration
de la Massachusetts Bay Company résidaient tous en Nlle-Angleterre et au plan
religieux, tout lien était rompu avec the
Church of England. « Sous le
gouvernement de John Endicott, la fidélité à l’idéal puritain atteint les
proportions de la plus cruelle intolérance » écrit F. Roz. Quant à
l’apport de la "civilisation" aux Indiens idolâtres, il
prit, presque immédiatement, la forme de la guerre avec l’usage des méthodes
pratiquées en Irlande. Cet état d’esprit explique les cris de joie du révérend
Cotton Mather qui célèbre l’anniversaire du massacre du 26 mai 1637 "ce jour-là, il est probable que nous avons envoyé pas
moins de six cents âmes pequots en enfer"[4]. Nous sommes loin de la dinde partagée convivialement
au premier Thanksgiving !
La colonie de Plymouth disparut en 1690, absorbée
par celle de Boston.
"Si elle eut peu d’importance au point de vue politique, elle exerça, au
point de vue religieux et moral, une influence considérable …" (ROZ).
La suite montrera que c’est plutôt les Endicott et
les Cotton Mather qui façonnèrent l’Amérique mais il est vrai qu’il y aura
toujours un courant fidèle à la tradition des Pilgrims Fathers pour exprimer un autre point de vue, fût-il
minoritaire. On aura compris également que les Puritans Fathers sont les ancêtres des futurs Insurgents qui rompront définitivement les liens avec l’Angleterre
lors de la guerre d’Indépendance.
Les Puritains ont maintenu la tradition du Thanksgiving, chaque année les médias
français s’empressent de nous le rappeler. Mais ce n’est plus une commémoration
de l’accueil humanitaire des Indiens, c’est une fête religieuse qui remercie le
Dieu des Américains d’en avoir fait une puissance dominante. Pour les
survivants des Natives, les quelques
Indiens qui connaissent l’histoire de leurs différentes ethnies, c’est le jour
de la catastrophe nationale.
Pour conclure, Rachel Cooper, Theodore Frelinghuysen
et d’autres, bien sûr,mais minoritaires, sont les descendants spirituels des Pilgrims
Fathers, des Pères pèlerins. Le pasteur Harry
Powell est un épigone dégénéré des Puritans Fathers,
des pères puritains, majoritaires depuis longtemps et pour longtemps.
[1] "The Loyalists of
America and their times", vol. I., 2° edition, 1880, (ré-imprimé
en 1970).
[2]
Qui écrit par exemple, qu’un "adventurer"
vécut assez "pour voir le succès des Pèlerins et des
Puritains dans le Massachusetts".
[3]
F. ROZ (Institut de France) "Histoire
des Etats-Unis", Fayard éditeur, Paris, 1930, nouvelle édition 1938,
486 pages..
[4]
Ce massacre est connu sous le nom de Mystic
massacre, parce qu’il eut lieu le long de la Mystic River. Les Pequots vivaient dans le Connecticut et ont été
anéantis. Pas tout à fait, car H. Zinn nous signale qu’en 1972, un recensement
dénombra 21 indiens Pequots dans cet Etat de la Nouvelle-Angleterre. Lire H. Zinn, pp. 20-22.
|
|
publié le 14 juin 2019, 07:20 par Jean-Pierre Rissoan
publié le 28 sept. 2012 à 16:24 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 30 sept. 2016 à 09:15
]
Ce film est un
chef-d’œuvre absolu qui marqua durablement mon enfance : c’est tout
dire ! La musique (oscar) du « si toi aussi tu m’abandonnes » et
la chute de la croix métallique du sheriff que Gary Cooper laisse choir à ses
pieds dans la poussière de la rue avant de quitter ses concitoyens minables
sans jeter un œil en arrière, tout cela je le revois et je l’entends de nouveau
à chaque fois.
Je dis quelques mots sur
ce film parce que je voulais évoquer le film Rio Bravo - Howard Hawks, 1959- qui est programmé au festival
Lumière-2012 de Lyon "Rio bravo" de Howard Hawks (1959). En me documentant, j’ai vu que Rio Bravo était une réplique à High
Noon, autre nom du film de Fred
Zinnemann. John Wayne, parangon de l’acteur américain défenseur des valeurs de son pays impérialiste, jamais
perturbé par le moindre doute, "in his Playboy interview from May 1971, stated he considered High Noon "the most un-American thing I’ve ever seen in my whole life"
and went on to say he would never regret having helped blacklist liberal
screenwriter Carl Foreman from Hollywood". Ce qui peut se
traduire de la manière suivante : "Wayne dans son entretien avec Playboy de mai 1971 déclara qu’il considérait High Noon comme le truc le plus antiaméricain qu’il a jamais vu de toute sa vie
et alla jusqu’à dire qu’il ne regrettera jamais d’avoir contribué à faire
inscrire le scénariste gauchiste Carl Foreman sur la liste noire d’Hollywood".
Foreman devra quitter les États-Unis -comme Dassin, comme Chaplin et
d’autres.. - pour poursuivre sa carrière.
Cette saillie de Wayne
s’explique de la manière suivante : le sheriff Will Kane - admirable et
définitif [1]
Gary Cooper, oscar du meilleur acteur - attend le train de midi qui déposera un
truand -Miller- qui vient se venger de lui. Trois compères attendent déjà ce
dernier à la gare. Quatre bandits prêts à tout, le sheriff cherche de l’aide.
Et alors tout se dérobe sous ses pieds. Sa fraîche épouse - quakeresse et, donc
non violente - l’enjoint de renoncer à toute épreuve de force. Son adjoint le
laisse tomber, un autre était d’accord mais à condition d’être nombreux, à deux
avec le sheriff, ça ne marche plus ! Un bistrot - un saloon ! on est au
Far West ! - rempli d’hommes qui chôment le jour du Seigneur- lui fait un
accueil d’abord glacial puis ricaneur : le sheriff n’a réussi à convaincre
personne ! Beaucoup de consommateurs sont même ravis du retour de Miller [2].
Au temple, Kane interrompt l’office, l’heure est trop grave. Les paroissiens
admettent le courage de Kane qui a débarrassé la ville d’un truand, mais on ne
veut pas d’ennui, la partie est perdue d’avance, que Kane s’en aille, Miller ne
trouvera personne face à lui, il n’y aura donc aucune victime !
Bref, le
peuple est lâche, c’est une débâcle morale, une débandade des valeurs…
l’Amérique est bien malade.
Cette succession de
dérobades est d’autant plus dramatique que l’heure d’arrivée du train approche.
Les multiples horloges, pendules, balanciers, réveils que l’on voit sans cesse
scandent le temps qui passe vite et l’on sait que l’un des traits de génie du
scénario du film est de faire correspondre 1 minute de scénario avec 1 minute
de temps réel. Sheriff Kane apprend l’arrivée de Miller à 10h37, le train
arrivera à High Noon : midi
pile. Le spectateur va rester 1h 23 minutes à attendre sur le gril les trois
sifflets de la machine à vapeur. Lorsque Miller est arrivé, il se
dirige immédiatement vers le centre-ville. C'est alors le grand
rendez-vous qui rend célèbre ces westerns américains, le gunfight final
comme disent les cinéphiles : chaque camp se dirige l'un vers l'autre,
la tension est au sommet. Les pleutres sont derrière leurs fenêtres :
ils attendent, mi-vautour, mi-vaches à traire.

De l’avis même des
persécutés d’ Hollywood - c’est l’époque de la chasse aux sorcières, de la
deuxième Red Scare [3],
on pourchasse tout ce qui pourrait être communiste - le film, le scénario
serait une métaphore de ce qu’ils subissent : la ville lâche, c’est
Hollywood qui laisse tomber tous ces/ses artistes qui ont fait la grandeur du
cinéma américain dans les années trente et quarante, l’arrivée de Miller, c’est
l’irruption de la Commission parlementaire d’enquête (HUAC) qui pourchasse les "Red",
faisant fi de tout respect des droits de l’homme, de la liberté de conscience,
et le sheriff, c’est l’un des 10 d’ Hollywood, blacklistés, voués au piloris sur la place publique, solitaire mais
conscient de ses droits et devoirs.
Cela peut cependant se
retourner comme une crêpe. Si on ignore le contexte de la guerre d’ Hollywood,
que voit-on ? Un homme seul, déterminé, sûr de son fait, qui affronte seul
l’ennemi et l’élimine. C’est le triomphe de l’action individuelle : c’est
le héros qui fait l’histoire comme disait Maurras, pas les masses populaires
comme le disaient Marx et les communistes d’ Hollywood. C’était d’ailleurs le
film préféré du président Eisenhower et R. Reagan déclara apprécier ce film
comme porteur des valeurs de la nation américaine.
D’ailleurs, cela montre la
monstruosité de la chasse aux sorcières : un scénariste communiste était
capable de construire des films édifiants pour le bon peuple, ce dernier fût-il
méprisable.
NB. Dans la série "the Sopranos", Tony Soprano -le boss - pose la question : mais où est passé Gary Cooper ? Il s'agit bien de celui de High noon, celui
qui se défend seul , fait face seul à l'adversité, celui qui n'a besoin
d’aucune aide. Bref, Tony appelle au secours l'Amérique, la vraie. John
Wayne était donc bien un imbécile.
[1]
« définitif » parce qu’aucun remake qui a été ou qui sera ne pourra
jamais égaler cette performance d’acteur : élégance, maitrise de soi,
force intérieure mais qui laisse parfois la place -car ce n'est pas une tête-brûlée - à la crainte sinon à la peur.
Magnifique.
[2]
Il est à noter que Rio Bravo
reprendra cette idée d’un saloon majoritairement fréquenté par les ennemis du
sheriff.
[3]
La première a eu lieu lors des années 1920’ avec l’arrivée des immigrants
méditerranéens -donc ni anglo-saxon, ni protestants - (affaire Sacco et Venzetti).
|
|
publié le 14 juin 2019, 06:50 par Jean-Pierre Rissoan
publié le 8 oct. 2012 à 16:45 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 13 sept. 2017 à 12:02
]
Film
programmé au festival Lumière-Lyon 2012.
Ainsi
que je l’ai souligné par ailleurs, "Le
train sifflera trois fois" (High Noon) avec Gary Cooper (1952) la
critique de Rio bravo est inséparable
de celle de High Noon dont le
scénario a été écrit par Carl Foreman, blacklisté d’ Hollywood. Il est donc
indispensable de s’informer sur ce film avant de lire ce qui suit et qui est
relatif à ce film d’ Howard Hawks Rio
bravo.
En
termes de cinéma de divertissement, disons-le de suite, Rio bravo est un excellent western qui se laisse voir avec plaisir.
Tous les ingrédients sont réunis : le sheriff et sa bande qui veut faire
régner l’ordre, le mauvais gars (Nathan Burdette) et sa bande qui veut faire
régner sa propre loi, la rousse sulfureuse - une femme libre est rare dans le
très masculin Ouest lointain du XIX° siècle américain, les braves gens plus ou
moins pleutres qui comptent les coups, la grand’rue sableuse, le saloon, la
bagarre finale (gunfight) toujours très attendue avec suspense préalable, etc…
En
réaction au film de Foreman, le sheriff de Rio
bravo n’est pas seul. Il a un adjoint (Dean Martin) et le gardien de la
prison municipale (Walter Brennan dans le rôle de Stumpy). Si John Wayne est
toujours aussi monolithique et inexpressif, Dean Martin -le Dude- interprète un sheriff déchu, ruiné
physiquement et mentalement par l’alcool. Quant à Walter Brennan il excelle
dans ces rôles de vieillards décalés, claudiquant, un peu fous. Tout cela
constitue une équipe de bric et de broc mais c’est une des leçons que le film
veut donner : tout le monde peut sauver l’Amérique !
Le
film est, en effet, aussi une histoire de rédemption. Et Dean Martin, du rôle
d’alcoolique, est appelé à se muer à celui d’authentique soldat de l’ordre qui
retrouve sa joie de vivre et sa voix de crooner
que complète harmonieusement l’harmonica. Au début du film, désargenté et
assoiffé, il quémande au saloon une pièce de monnaie qu’accepte de lui donner
un gars de la bande adverse mais en la jetant dans le crachoir au pied du
comptoir... et le Dude s’abaisse à la prendre mais le sheriff veille et donne
un coup de pied dans le crachoir… Puis, le Dude traverse une crise morale
intense qui lui fait réaliser qu’il n’est qu’un raté, une merde, et que
l’alternative est d’en finir ou de se ressaisir. Ce thème de la nouvelle chance
donnée à des marginaux constitue la trame de films comme Les douze salopards. C’est en réalité un thème religieux ancien
créé, sauf erreur, par Bernard de Cîteaux. Au XII° siècle, ce moine-soldat,
initiateur des croisades, pense que les plus criminels des hommes peuvent être sauvés
: "Admirez les abîmes de la miséricorde du Seigneur" prêche
Bernard, "n'est-ce pas une invention exquise et digne de lui que
d'admettre à son service des homicides, des ravisseurs, des adultères, des
parjures et tant d'autres criminels et de leur offrir par ce moyen une occasion
de salut ? Ayez confiance, pécheurs, Dieu est bon". Dans la pieuse
Amérique anti-communiste de la Guerre froide et de John Wayne, cette
interprétation salvatrice est…pain béni.
Ce
trio est renforcé progressivement. La « rousse sulfureuse » (Angie
Dickinson, aux formes adéquates), une joueuse-tricheuse de poker, tombe
amoureuse du sheriff, un homme un vrai. Son rôle n’est pas capital dans la
défaite de la bande à Burdette mais enfin, elle s’implique. L’homme d’armes,
chargé de veiller à la sécurité d’un ami du sheriff, après avoir refusé d’aider
ce dernier, se ravise après l'assassinat de son patron et deviendra même
sheriff-adjoint. Même l’hôtelier - il y a toujours un hôtel dans les westerns -
prendra part à bagarre finale. Bref, on le constate, à la grande différence de High Noon, film
« anti-américain » selon J. Wayne, il y a du monde dans la ville de Rio bravo pour
défendre la loi, l’ordre, Dieu et son roi. Pardon, Dieu et l’Amérique élue.
Rio bravo a une richesse baroque, colorée, costumée. H. Hawks
est très à l’aise avec sa caméra pour embrasser des plans larges et filmer
des scènes à rebondissements. On peut préférer Le train sifflera trois fois, en noir et blanc, une épure, une
stylisation. La finesse absolue.
|
|
|