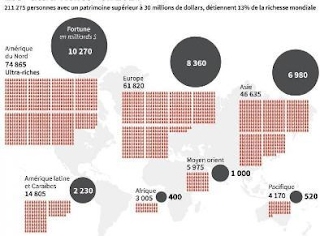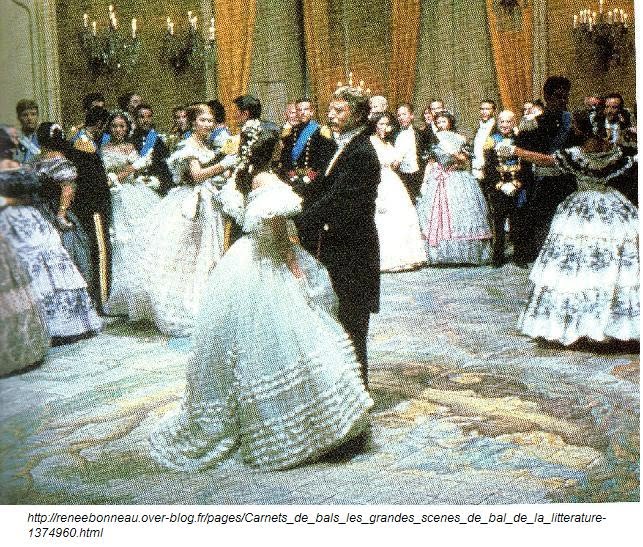-
1919 : naissance de l'Organisation internationale du Travail.
UN SIÈCLE DE NORMES INTERNATIONALES POUR PROMOUVOIR LA "JUSTICE SOCIALE"
L’Organisation internationale du travail (OIT) voit le jour en
1919, au lendemain des horreurs de la Première Guerre mondiale ...
Publié à 11 juin 2019, 03:13 par Jean-Pierre Rissoan
-
Vers une ploutocratie mondiale ? (2ème partie)...
à lire d'abord : Vers une ploutocratie mondiale ...Le Richistan toujours plus coupé du monde Thomas LemahieuLundi, 18 Janvier, 2016L'Humanité Dans
une étude divulguée ce lundi, Oxfam ...
Publié à 13 sept. 2018, 07:25 par Jean-Pierre Rissoan
-
Vers une ploutocratie mondiale ...
INÉGALITÉS EXTRÊMES : DÉMOCRATIE EN DANGER
par Stéphane AUBOUARD
Mots clés : inégalités, davos, forum économique
mondial, rapport
oxfam,
Tandis
que s’ouvre aujourd’hui la 44° édition du forum économique mondial ...
Publié à 27 juil. 2016, 09:50 par Jean-Pierre Rissoan
-
Inégalités : le retour des pharaons...article du MONDE DIPLOMATIQUE
je publie cet article du Diplo, comme disent les gens branchés, article qui va parfaitement dans le sens de ceux de cette série et que j'avais intitulés 1914 -2014 ...
Publié à 15 mai 2013, 05:39 par Jean-Pierre Rissoan
-
1914 -2014 : patrimoines et revenus du patrimoine, ça explose !
publié le 23 oct. 2012 19:20 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 5 nov. 2012 19:05
]
les chapeaux d' Ascott, photo du film "My fair lady".
L ...
Publié à 16 janv. 2019, 01:16 par Jean-Pierre Rissoan
-
les marchés financiers ? c'est l'oligarchie !
publié le 8 mars 2012 10:34 par Jean-Pierre Rissoan
par Geoffrey
GeuensEt d’abord qui est Geoffrey
Geuens ?
Chargé de
cours au département "arts
et sciences de ...
Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan
-
SUR LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux fortunes d'antan, par Th. PIKETTY
publié le 24 oct. 2012 11:50 par Jean-Pierre Rissoan
Soucieux du respect qu’on doit à
un auteur et à son texte, je publie intégralement l’article de ...
Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan
-
MAIS QUI SONT LES AGENTS DES MARCHES FINANCIERS ?
publié le 15 nov. 2011 18:30
par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 21
nov. 2011 12:01
]
Cet
article est un daille-geste
-un digest, si vous préférez ...
Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan
-
L' envolée des fortunes...
publié le 24 nov. 2011 12:24
par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 24
nov. 2011 23:22
]
Mme
Deborah Hargreaves est
présidente du groupe britannique de recherche sur ...
Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan
|
publié le 11 juin 2019, 03:13 par Jean-Pierre Rissoan
UN SIÈCLE DE NORMES INTERNATIONALES POUR PROMOUVOIR LA "JUSTICE SOCIALE"
L’Organisation internationale du travail (OIT) voit le jour en
1919, au lendemain des horreurs de la Première Guerre mondiale, avec la
conviction qu’ "une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la
justice sociale". Les piliers de son action sociale reposent sur la
législation du travail, la redistribution et la négociation collective (syndicalisme et
dialogue social). En 1946, l’ OIT est la seule institution de l’ONU à
avoir une structure tripartite : les gouvernements, les travailleurs et les employeurs y sont
représentés à parts égales. Les centaines de normes internationales
définies par ses États membres constituent des références dont peuvent se saisir les travailleurs,
les travailleuses et leurs représentants. Après la chute du mur de
Berlin et du bloc soviétique, l’organisation fait face à de nouveaux
défis avec la globalisation néolibérale de l’économie, dont ses acteurs
considèrent la faiblesse des salaires et des protections sociales comme des atouts. En 2002, elle crée une commission sur la dimension sociale de la mondialisation. Ces récentes années, l’ OIT s’est efforcée de s’adapter à l’évolution des événements. À ce
jour, les travailleurs sans contrat des plateformes numériques sont peu
couverts par les conventions de l’institution.
Émanation
du traité de Versailles en 1919 au sortir de la Première Guerre
mondiale, l’Organisation internationale du travail (OIT) célèbre ces
jours-ci à Genève (Suisse) son centenaire en grande pompe. Fondé sur
l’idée qu’« il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans
un traitement décent des travailleurs », cet organisme d’un genre un peu
spécial du fait de son tripartisme – employeurs, salariés et États y
disposent de représentants à égalité – a non seulement survécu aux
guerres et aux mutations géopolitiques, mais a surtout produit quantité
de normes qui ont contribué à améliorer le sort des travailleurs dans le
monde. Pourtant, face aux offensives réactionnaires, à l’aggravation du
dumping social et aux évolutions techno-logiques de ces dernières
décennies, cette agence de l’ONU semble incapable de réguler certains
des excès les plus manifestes du patronat. En dépit de ces limites
évidentes, nombre de travailleurs, y compris en France, continuent de se
saisir de l’OIT comme d’un outil de résistance face à la dégradation de
leurs conditions de travail.
Car, réforme après réforme, la casse du Code du travail
dans l’Hexagone a été telle que le caractère juridiquement contraignant
des conventions OIT, dont la France est signataire, sert de plus en plus
de point d’appui aux salariés devant les juridictions nationales.
L’exemple le plus récent et le plus médiatisé a été la fronde des
prud’hommes contre le barème instituant un plafonnement des indemnités
accordées aux salariés dont le licenciement est reconnu sans cause
réelle et sérieuse. Introduite par les ordonnances Macron en 2017, cette
mesure, qui prive le juge d’une appréciation réelle et individualisée
du préjudice subi par le salarié pour favoriser une sécurisation de
l’employeur, qui connaît à l’avance le montant qu’il devra provisionner
lorsqu’il aura recours à un licenciement abusif, a été rejetée par plus
d’une quinzaine de conseils de prud’hommes ces derniers mois. Et ce,
toujours sur la base de l’inconventionnalité de cet article de loi,
c’est-à-dire que celui-ci est considéré comme entrant en violation des
articles 4 et 10 de la convention OIT 158. Ceux-ci précisent en effet
qu’« un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un
motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service » et que si un
licenciement est reconnu injustifié par les autorités ou tribunaux
compétents et qu’une réintégration du salarié est jugée impossible,
« ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité
adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme
appropriée ».
L’OIT reste encore créatrice de normes internationales
C’est aussi sur une convention OIT, celle portant le
numéro 81, que s’appuient les inspecteurs du travail pour défendre leur
indépendance vis-à-vis de pressions de leur hiérarchie comme des
employeurs. C’est ainsi que l’ex-inspectrice du travail d’Annecy, Laura
Pfeiffer, s’était défendue en 2013 des interventions de l’entreprise
Tefal auprès de sa hiérarchie pour tenter de la mettre au pas. « Le
personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le
statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans
leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de
gouvernement et de toute influence extérieure indue », dispose
l’article 6 de la convention 81. Encore aujourd’hui, c’est ce texte que
les fonctionnaires du ministère du Travail invoquent pour résister aux
politiques chiffrées que Grenelle veut imposer ces derniers mois.
Mais l’OIT peut jouer en elle-même le rôle d’arbitre en
recevant directement des réclamations de la part des organisations
professionnelles d’employeurs ou de travailleurs. Ces dernières années,
la CGT avait notamment obtenu gain de cause auprès de l’agence de l’ONU,
qui avait fortement critiqué en 2007 le contrat nouvelle embauche,
ainsi que le recours aux réquisitions de salariés grévistes dans le
secteur pétrolier pendant le mouvement contre la réforme des retraites
de 2010. En 2017, la CGT et FO avaient saisi l’OIT concernant deux
dispositions introduites par la loi El Khomri de 2016 : le développement
de l’inversion de la hiérarchie des normes et les licenciements en cas
de refus d’un salarié d’appliquer un accord de préservation et de
développement dans l’emploi. Cette procédure, déclarée recevable, est
toujours en instance. En mars dernier, c’est la CGT Ford qui a décidé de
porter son combat contre la fermeture de l’usine de Blanquefort devant
l’organisation internationale, estimant que le constructeur automobile
enfreignait les engagements conventionnels de la France en matière de
justification des licenciements.
Enfin, l’OIT reste encore créatrice de normes
internationales. Pour preuve, celle qui sera âprement négociée durant
quinze jours pour ce centenaire : une nouvelle convention, la 190e,
contre les violences et le harcèlement au travail avec une
identification très forte des violences fondées sur le genre. « L’enjeu,
c’est d’avoir une norme internationale qui protège les femmes des
violences sexistes et sexuelles avec un aspect responsabilité de
l’employeur, interdiction des violences, mesures de protection des
victimes et prévention », explique Sophie Binet, membre de la CGT et
négociatrice pour le collège travailleurs. Une norme ambitieuse et
transverse qui veut aussi inclure les violences pendant le trajet menant
au travail, dans les dortoirs où sont parfois logées les travailleuses
comme les ouvrières du textile en Asie, mais aussi les violences
conjugales. Le volet recommandations précisera la mise en place de
mesures concrètes, comme celle inspirée par l’Australie et le Canada qui
impose des congés de droit pour les femmes victimes de violences
conjugales, après constatation médicale ou plainte : « Cet accès à des
congés de droit permet aux victimes d’organiser leurs démarches et de se
défendre tout simplement, argumente la dirigeante de la CGT en charge
de l’égalité femmes-hommes. Parce que la première conséquence pour une
femme victime de violences conjugales, c’est bien souvent la perte de
son emploi, ce qui l’enferme dans une spirale catastrophique. »
Les violences contre les femmes au cœur de la prochaine convention
Dans cette négociation tripartite, le camp des
travailleuses et des travailleurs a réussi à construire une plateforme
de revendications exigeante, malgré des cultures et situations très
différentes selon les pays : inverser la charge de la preuve, obtenir
une formation généralisée sur ces questions de violence, identifier et
spécifier les violences fondées sur le genre qui sont au cœur des
rapports de domination. Si le « féminisme washing », où l’art d’utiliser
l’étiquette féministe pour redorer le blason des sociétés, a pu jouer
auprès d’entreprises interpellées, la majorité des employeurs restent
réticents à toute forme de texte normatif qui empêcherait un dumping
social organisé à l’échelle mondiale. « En France, par exemple, ça fait
des années qu’on demande que ce soit un sujet de négociation obligatoire
à l’entreprise et le patronat refuse. Il y a un déni. », confirme
Sophie Binet. Quant aux États, qui doivent ratifier aux deux tiers la
norme pour qu’elle soit validée, il suffit d’écouter les saillies de
Donald Trump, Jair Bolsonaro ou Recep Tayyip Erdoğan pour comprendre que
la bataille n’est pas gagnée d’avance. « C’est un combat qui prend en
frontal et à revers cette contre-révolution conservatrice qui amène
l’extrême droite au pouvoir dans de plus en plus de pays, estime la
syndicaliste. Contrairement à ce qu’on entend parfois, ce n’est pas la
tarte à la crème et un sujet consensuel gagné d’avance, loin de là ! »
Si la campagne syndicale internationale pour instaurer une norme
mondiale contre les violences faites aux femmes avait commencé bien
avant la déferlante #MeToo, le contexte actuel la rend encore plus
incontournable. Et redonnerait à l’OIT, pour ses 100 ans, le dynamisme
de la jeunesse.
Kareen Janselme et Loan Nguyen |
publié le 22 janv. 2016, 00:52 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 13 sept. 2018, 07:25
]
Le Richistan toujours plus coupé du monde L'Humanité
 Dans
une étude divulguée ce lundi, Oxfam dresse un bilan ravageur de
l’explosion de l’injustice sociale à l’échelle planétaire. Une poignée
d’ultra-fortunés détient autant de richesses que la moitié de
l’humanité. Dans
une étude divulguée ce lundi, Oxfam dresse un bilan ravageur de
l’explosion de l’injustice sociale à l’échelle planétaire. Une poignée
d’ultra-fortunés détient autant de richesses que la moitié de
l’humanité.
À
quelques jours des libations occasionnées par la noce annuelle des
grandes puissances financières et politiques à Davos (Suisse), Oxfam
jette un gros pavé dans ce marigot. Dans un rapport rendu public ce
lundi et intitulé « Une économie au service du 1 % », l’ONG, spécialisée
dans la lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale, s’indigne
de l’explosion des inégalités à l’échelle de la planète. Selon ses
calculs, en 2015, 62 individus détiennent à eux seuls des richesses
équivalant à celles des 3,5 milliards de personnes les plus pauvres,
alors qu’il y a cinq ans les ultra-riches pesant autant que la moitié de
l’humanité étaient encore 388. Entre 2010 et aujourd’hui, la fortune de
ces 62 privilégiés, estimée à 1 760 milliards de dollars, a augmenté de
542 milliards de dollars (+ 44 %), quand la moitié la plus pauvre de
l’humanité a vu, elle, ses ressources diminuer de plus de mille
milliards de dollars (- 41 %). En élargissant un peu la focale, Oxfam
s’appuie sur des données contenues dans une étude du Crédit Suisse
révélant que les 1 % des plus riches ont désormais accumulé plus de
richesses que le reste de la population mondiale. Depuis le début du
siècle, la moitié la plus pauvre de l’humanité n’a bénéficié que de 1 %
de l’augmentation totale des richesses, alors que les 1 % les plus
riches se sont accaparés la moitié de cette augmentation. 
Au cœur du dispositif, les paradis fiscaux
À partir de ces chiffres, Oxfam se livre à un réquisitoire
contre un « modèle économique fortement biaisé » en faveur des plus
fortunés. « En lieu et place du ruissellement attendu sur les couches
inférieures de la population, les revenus et les richesses sont aspirées
à un rythme alarmant par cette élite », écrit l’ONG. Au cœur du
dispositif, les paradis fiscaux – les Bermudes, les îles Caïmans,
Singapour, Panama, la Suisse, mais aussi le Luxembourg, l’Irlande, les
Pays-Bas et Jersey sont particulièrement mis en avant – garantissent que
l’argent ainsi détourné reste hors de portée des États et des citoyens
ordinaires. D’après une estimation de l’économiste Gabriel Zucman,
reprise par Oxfam, 7 600 milliards de dollars, soit plus que les PIB de
l’Allemagne et du Royaume-Uni additionnés, sont déposés sur des comptes
offshore par des particuliers. L’ONG dénonce également le boom des
pratiques d’optimisation fiscale inventées par les gestionnaires de
patrimoine qui, dans la mondialisation financière, sont comme des
poissons dans l’eau. « Seules les entreprises et les particuliers les
plus fortunés – à savoir ceux qui devraient payer le plus d’impôts – ont
les moyens de recourir à ces services et à ce maillage international
pour éviter de payer ce qui est dû, relève Oxfam. Cela pousse
indirectement les États qui ne sont pas des paradis fiscaux à alléger
leur fiscalité sur les entreprises et sur les particuliers fortunés et
ainsi à s’embarquer dans un implacable “nivellement par le bas”.
L’assiette fiscale diminue du fait de cette optimisation généralisée, et
ce sont les budgets des gouvernements qui en subissent les effets,
engendrant des coupures dans les services publics de première nécessité.
Les gouvernements se tournent donc de plus en plus vers l’imposition
indirecte, comme la TVA, qui affecte de manière disproportionnée les
plus pauvres. L’optimisation fiscale est un phénomène qui empire
rapidement. »
Toute cette ingénierie purement financière ne produit
aucune richesse réelle pour la collectivité, mais, pire encore, accuse
l’ONG, elle fragilise énormément les États qui n’ont pas les ressources
nécessaires pour lutter contre la pauvreté et protéger les services
publics les plus élémentaires. Selon Oxfam, « près d’un tiers de la
fortune des riches Africains, soit 500 milliards de dollars, est placé
sur des comptes offshore dans des paradis fiscaux. On estime que cela
représente un manque à gagner fiscal de 14 milliards de dollars par an
pour les pays africains. Cette somme couvrirait à elle seule les soins
de santé susceptibles de sauver la vie de 4 millions d’enfants et
permettrait d’employer suffisamment d’enseignants pour pouvoir
scolariser tous les enfants africains ». Au-delà des revendications sur
les salaires décents et sur la fin du transfert des richesses produites
vers le capital, Oxfam International, dont la directrice générale Winnie
Byanyima sera présente à Davos, appelle en priorité les dirigeants
mondiaux à « s’entendre sur une approche globale pour éradiquer les
paradis fiscaux ». Maintenant que le fameux slogan du mouvement Occupy
Wall Street – « Nous sommes les 99 % » – est rattrapé par la réalité, il
est plus que temps d’agir.
PS. de J.-P. R.
il s'agit là d'un article de L'Humanité. Mais le journal La Croix a pris parti, de son côté, contre cette inégalité scandaleuse. Et, en effet, cette aberration ne peut que révolter notre bon pape François...
addendum L’endormissement
provoqué par l’unanimisme du monolithe médiatique nous conduit peu à peu au
cauchemar. Après l’émission très instructive d’ARTE sur STARBUCKS j’ai fait un
rapprochement inquiétant entre les propos de Scott Bedbury, directeur du
marketing de Starbucks et ceux de Geoffroy Rue de Béziers, le successeur de P.
Gattaz. Le premier a dit : "Nous
plaçons notre confiance dans les marques. Une marque n’est pas seulement un
produit, c’est comme une religion. Certaines sont très bonnes pour tenir cette
promesse. Starbucks c’est 15 millions de cafés par jour, cela crée de la
confiance et le défi de Starbucks c’est de promettre exactement la même
expérience où que vous soyez. (…)". Et il lança en conclusion "La confiance dans les institutions
(politiques) s’est effondrée aux USA. On ne se fait même plus confiance les uns
les autres. Les grandes entreprises doivent se mobiliser car elles représentent
la démocratie (sic), en particulier dans un pays comme le nôtre. Et elles la
protègent. Je pense plus que jamais que nous, les FMN, nous devons nous efforcer
de construire un monde meilleur".
Quant
au successeur de Pierre Gattaz, il a vu dans le départ de Nicolas Hulot du
gouvernement une occasion de plaider pour un monde livré aux grands "entrepreneurs". "Dans le spatial, les biotechnologies, la
médecine, l'initiative est maintenant du côté du secteur privé. Ce sont les
entrepreneurs qui vont relever la plupart des défis présents et à venir: transition
énergétique, biodiversité, urbanisation", a-t-il assené. Et de
s'exclamer : "Aujourd'hui, ce sont
les entrepreneurs qui changent le monde !" La référence à Google et Facebook
(il n’a pas regardé l’émission d’ARTE), que Geoffroy Roux de Bézieux n'a pas
manqué de citer, laisse présager les conditions sociales, démocratiques et
environnementales d'un tel monde. "Un
tiers des consommateurs choisit désormais ses marques en fonction de leur
impact environnemental ou social. Ils attendent des entreprises qu'elles soient
des acteurs du changement sociétal.".
Chez
STARBUCKS, les horaires sont mobiles et les salaires font le yo-yo, le PDG
vient de s’acheter une maison de 25 millions de dollars. Ce n’est pas le seul
élément de son patrimoine, rassurez-vous et ses gobelets ont toujours un revêtement
intérieur plastic.(septembre 2018) J.-P. R.
|
publié le 24 janv. 2014, 09:08 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 27 juil. 2016, 09:50
]
INÉGALITÉS EXTRÊMES : DÉMOCRATIE EN DANGER
par Stéphane AUBOUARD
Mots clés : inégalités, davos, forum économique
mondial, rapport
oxfam,
Tandis
que s’ouvre aujourd’hui la 44° édition du forum économique mondial de Davos,
l’ONG Oxfam
sort un rapport inquiétant sur
l’accroissement des inégalités entre riches et pauvres.
"La concentration massive des ressources économiques
dans les mains de toujours moins de personnes constitue une réelle menace pour
les systèmes économiques et sociaux".
Les défenseurs zélés du capitalisme croiront sans doute cette formule tirée
d’un manuel marxiste du XIXe siècle, et pourtant, c’est bien aujourd’hui, dans
le dernier rapport d’Oxfam sur les inégalités économiques, que ces quelques
lignes ont été écrites. Tandis que les puissants de la planète se regroupent ce
mercredi (22 janvier 2014) à Davos, l’ONG tire la sonnette d’alarme, invitant
les décideurs du forum mondial à prendre conscience d’une situation de plus en
plus critique et dont les habitués de la station suisse ne semblent pourtant
pas ignorer la gravité. En novembre 2013, le forum économique mondial
n’affirmait-il pas lui-même dans son rapport, "Outlook On The Global Agenda 2014", que l’un des deux principaux risques des dix-huit
prochains mois était l’accroissement des disparités de revenus ? Les
personnes interrogées précisant que ces inégalités "affectaient
la stabilité sociale au sein des pays" et "menaçaient la
sécurité dans le monde". .jpg) Oxfam
fait donc le même constat dans ce nouveau rapport, basé sur plusieurs sondages,
intitulé "Pour en
finir avec les inégalités extrêmes",
avec des analyses et des chiffres (voir infographie ci-dessus) souvent
alarmants. Ainsi les 85 personnes les plus riches du monde posséderaient à elles seules
l’équivalent de la richesse de la moitié la moins riche de la planète (soit
plus de 3 milliards d’individus). De 1980 à 2012, les 1 % les plus
riches aurait augmenté leur part de revenus dans 24 pays sur 26 étudiés. Sept
personnes sur dix sur l’ensemble de la planète estiment également vivre dans un
pays où le fossé des inégalités s’est creusé depuis trente ans. Mais qu’elles
soient issues des pays émergents ou de pays développés, les personnes
interrogées ne sont pas dupes. En Inde, au Brésil, en Espagne, en Afrique du
Sud, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, "une
majorité de la population pense que les lois sont biaisées en faveur des riches". Aux États-Unis par exemple, 65 % des sondés sont
convaincus que le Congrès adopte des lois qui bénéficient surtout aux riches.
Ce que l’ONG analyse comme suit : "Lorsque les plus riches confisquent les politiques
gouvernementales, cela conduit à l’érosion de la gouvernance démocratique".
Des politiques d’austérité qui permettent
aux riches de s’enrichir davantage
Une
érosion de la démocratie dont la source remonte au début des années 1980 avec
les politiques ultralibérales mises en œuvre sous Reagan aux États-Unis et
Thatcher au Royaume-Uni, qui feront le nid de la crise de 2008, véritable
accélérateur d’inégalités entre riches et pauvres… Mais aussi entre travail et
capital. "Alors que les actions et les profits des
entreprises atteignent des niveaux vertigineux, les salaires stagnent", constate Oxfam, illustrant son affirmation par
l’exemple européen : "Entre 2008 et 2010, la fortune combinée des 10 personnes
les plus riches d’Europe dépasse le coût total des mesures de relance mises en
place dans l’Union européenne ! (217 milliards d’euros contre 200 milliards d’euros". Une situation absurde, loin d’être le fruit d’un
hasard cupide et qui, pour l’ONG, porte un nom : "Les politiques d’austérité mises en
place après la crise pèsent lourdement sur les personnes pauvres alors qu’elles
permettent aux riches de s’enrichir toujours plus !".
Pour
éviter l’explosion sociale que redoutent tant les membres du club de Davos, le
texte invite ceux-ci à renverser la vapeur en piochant dans un passé récent. "Il existe
heureusement des exemples indéniables de succès durant les trois décennies qui
ont suivi la Seconde Guerre mondiale, rappelle l’ONG. Les États-Unis et
l’Europe ont réduit les inégalités tout en connaissant croissance et
prospérité. L’Amérique latine les a elle aussi réduites ces dix dernières
années par le biais d’une fiscalité plus progressive". Dans l’un et l’autre cas, des politiques de services
publics et de protection sociale étaient alors accompagnées par une législation
du travail en faveur des salariés. Un conseil que les quatre ministres français
qui seront présents à Davos pourront peut-être faire remonter à François
Hollande à l’heure où son pacte de responsabilité et ses 30 milliards d’euros
de cadeaux faits aux patrons taillent encore un peu plus dans la chair d’une
démocratie dont l’épitaphe, si rien ne bouge, pourrait être les derniers mots de
ce rapport. "Sans une
véritable action pour réduire ces inégalités, les privilèges et les
désavantages se transmettront de génération en génération comme sous l’Ancien
Régime".
États Unis : l’exemple à ne pas suivre
Dans
son rapport, Oxfam rappelle le rôle pernicieux de l’argent dans le jeu
politique américain : "Depuis la fin des années 1970, un contrôle
insuffisant de l’argent dans la politique a permis à de riches individus et
entreprises d’exercer une influence injustifiée sur l’élaboration des
politiques du gouvernement. L’une des conséquences pernicieuses a été la création
de politiques publiques biaisées en faveur des intérêts d’une élite, qui a coïncidé
avec la plus forte concentration des richesses entre les mains de 1% des plus
riches". Du coup, le pouvoir de négociation des syndicats s’est
effondré et la valeur réelle du salaire minimum et d’autres mesures de
protection s’est érodée. Dans le même temps, "de riches
lobbies ont su influencer le législateur et le grand public afin de minimiser la
pression fiscale sur les plus hauts salaires et les gains en capital, mais
aussi pour créer des échappatoires fiscales pour les entreprises". Comme le capital est moins imposé que les salaires,
des millions d’Américains de la classe moyenne ont un taux d’imposition plus
élevé que les riches.
Stéphane AUBOUARD
Article paru dans l’Humanité du 22 janvier 2014 poursuivre : Vers une ploutocratie mondiale ? (2ème partie)...
addendum :
TOUJOURS PLUS !
Une
nouvelle étude confirme que les ultra-riches concentrent de plus en
plus de richesses. Malgré la crise, leur nombre augmente, et leur
richesse encore plus. Cette
étude de WealthX et de la banque UBS recense les très riches qui ont
amassés plus de 30 millions de dollars. Ils sont 211000, soit une
augmentation de 6 % sur un an, et leur patrimoine cumulé a lui augmenté
de 7 %. Ainsi possèdent -ils à eux seuls 13 % de la richesse mondiale.
Ils
sont de mieux en mieux répartis dans le monde, même si les Etats-Unis
abritent toujours le plus gros contingent d'ultra-riches, suivis de
l'Europe et de l'Asie. Le continent africain reste en dernière place,
avec 3005 ultra-riche, mais c'est là que l'augmentation est la plus
forte, avec une augmentation de 8,3 %.
La richesse cumulée de ces 211000 ultra-riches atteint les 30.000
milliards de dollars. C'est quasiment le PIB cumulé de l'Europe et des
Etats-Unis. Presque la moitié du PIB mondial. C'est 3 fois le montant de
toutes les dettes souveraines cumulées des pays européens.
L'augmentation de cette richesse se fait principalement sur les marchés
financiers, repartis comme s'il n'y avait jamais eu de crise. Toutefois,
un tiers de ces ultra-riches ont hérité du gros de leur fortune. Au
niveau mondial, ce club est à une écrasante majorité (87%) composé
d'hommes dont l'âge moyen est de 59 ans.
|
publié le 15 mai 2013, 05:39 par Jean-Pierre Rissoan
J.-P. R.
Inégalités : le retour des pharaons
« Les inégalités ont toujours existé »,
entend-on souvent dire par ceux qui aimeraient banaliser leur flambée.
Certes, mais elles étaient encore plus prononcées du temps des pharaons.
Notre modernité s’inspirerait-elle donc du temps de l'Égypte ancienne ?
Ainsi que le rappelle Business Week (1),
qui ne passe pas pour une publication anticapitaliste, le très célèbre
théoricien du management Peter Drucker avait théorisé en 1977 qu’une
entreprise dans laquelle les écarts de salaires dépassaient un rapport
de 1 à 25 voyait ses performances diminuer. Car plus les inégalités se
creusent, plus une mentalité individualiste destructrice sape le travail
collectif, l’esprit d’équipe et, au final, les résultats de
l’entreprise, y compris pour ses actionnaires. Être payé autant en une
journée que d’autres en un mois semblait donc représenter la limite à ne
pas dépasser. Non pas tant pour les ouvriers et employés qui, en
général, ne se font guère d’illusion sur le côté « famille heureuse » de la structure privée qui les emploie (« Ils sont déjà persuadés, écrivait Drucker, que leurs patrons sont des escrocs »).
C’est donc plutôt de l’encadrement que les problèmes surgiraient :
au-delà d’un certain écart de rémunération, le cynisme gagne, le cœur à
l’ouvrage se perd, l’absentéisme s’envole.
Logiquement, Business Week a donc voulu savoir quelle était la
situation actuelle aux États-Unis. C’est peu de dire que l’écart de 1 à
25 est pulvérisé. J. C. Penney, qui vend des chemises et des pantalons
bon marché, permet aussi à son patron de ne pas se soucier de faire des
économies vestimentaires. Chaque jour, la rémunération de Ronald Johnson
correspond en effet à plus de six années de salaire d’un de ses
employés. Car l’écart va de 1 à 1 795 entre la paie annuelle du premier
(53,3 millions de dollars) et celle du vendeur moyen (vraisemblablement
une vendeuse…), de J. C. Penney (29 000 dollars). A Abercrombie (2), médaille d’argent de l’iniquité, l’écart va de 1 à 1 640.
Parmi les autres « lauréats »
de ce classement, Starbucks est cinquième (écart de 1 à 1 135). Et
Ralph Lauren, Nike, Ebay, Honeywell, Walt Disney, Wal-Mart et Macy’s se
disputent les vingt premières places. A Intel, centième (et dernier) de
la liste, l’égalité n’est pas tout à fait réalisée non plus, mais
l’écart n’est « que » de 1 à… 299 (3).
Bien sûr, certains vont trouver injuste de mettre sur le même plan la rémunération d’un « capitaine d’industrie »
— forcément brillant, talentueux, innovant — avec celle d’un de ses
employés qui, lui, n’aurait d’autre souci dans la vie que d’obéir.
L’étude d’une autre publication, tout aussi peu subversive que Business Week, risque par conséquent de les décontenancer. Consacrant un dossier détaillé aux « Entreprises plus fortes que les Etats », L’Expansion
(mai 2013) a cette fois comparé la rémunération des patrons du privé
avec celle de responsables politiques de premier plan, à qui il arrive
peut-être, à la Maison Blanche ou à l’Elysée, de prendre des décisions
qui ne sont pas insignifiantes. On apprend alors que M. Tim Cook, patron
d’Apple gagne près de 1 000 fois le salaire annuel de son compatriote
Barack Obama (378 millions de dollars dans un cas, 400 000 dollars dans
l’autre). Et que M. Maurice Lévy, patron (intouchable) de Publicis, s’attribue 127 fois la rémunération de son compatriote François Hollande.
(2) L’enseigne de prêt-à-porter s’est encore illustrée récemment, comme le relevait Rue89, par son refus de faire don des vêtements invendus, préférant les brûler.
(3) Le patron d’Intel, Paul Otellini, s’adjuge 17,5 millions de dollars par an, contre 58 400 dollars à son salarié moyen.
|
publié le 22 févr. 2013, 01:23 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 16 janv. 2019, 01:16
]
publié le 23 oct. 2012 19:20 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 5 nov. 2012 19:05
]
les chapeaux d' Ascott, photo du film "My fair lady".
L’économiste
Thomas Piketty a fait une thèse qu’il a publiée[1] :
il en a donné la substantifique moelle dans le Monde diplomatique, numéro de septembre 2001, par un article que j’ai
exploité pour l’écriture de mon livre (chapitre 24, intitulé Et aujourd’hui ?, accessible gratuitement
sur ce site) et que je vais exploiter maintenant à nouveau, article qui est intitulé "SUR
LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux fortunes d'antan".
La formule-clé, selon moi et « retour aux fortunes
d’antan ». NB. Tout ce qui
est écrit en bleu relève de T. Piketty, les graphiques sont extraits de
l’article de l’Humanité-dimanche du 11 octobre 2012 [2].
RETOUR AUX FORTUNES D'ANTAN
En
effet, en lisant l’Humanité-Dimanche du 11 octobre 2012, je suis tombé sur le
graphique suivant :
 Cela
fait tilt ! n’est-ce pas ? notez qu’il n’y a aucune raison pour qu’un
chercheur authentique ou qu’un hebdomadaire sérieux publient des sottises. Mais
enfin le rapprochement est intellectuellement éblouissant.
Ah ! la Belle époque que voilà…
La
"Belle époque" où l’argent ruisselait de partout dans les châteaux et
manoirs et hôtels particuliers est appelée « edwardienne period » en Angleterre : c’est, en effet, un
phénomène général qui correspond à une phase A d’un cycle Kondratieff. Époque
d’autant plus belle qu’elle suit, par définition, une phase B -the great deep- des Anglais où tout baissait : prix, bénéfices,
salaires, profits, et où une seule chose augmentait ; le chômage. Rien de
tout cela durant la Belle époque : le "surplus"[3] des
économistes dégouline de partout. Mais cette période bénie est l’épanouissement
de tout un siècle d’accumulation.
En 1884, il y avait cinq Anglais parmi les douze
hommes les plus riches du monde. Le baron de Rothschild, le duc de Westminster,
le duc de Sutherland, le duc de Northumberland et le marquis de Bute.
Sutherland était le plus grand propriétaire foncier avec 482.000 hectares[4]. Sept propriétaires
possédaient chacun plus de 200.000 hectares. Le marquis de Breadalbane pouvait
parcourir à cheval trente-trois heures en ligne droite sans sortir de ses
terres. Le septième de la superficie totale du Royaume Uni était dans les mains
de quatre-vingt-dix propriétaires dont soixante-sept figuraient au ''peerage'' c’est-à-dire étaient membres
de la chambre des Lords. Il s’agit là des noblemen
et non des gentlemen qui sont la
catégorie en-dessous.
Figure supprimée par manque de place, visible sur la fiche MORT A VENISE, Luchino Visconti, 1971.ci-dessus : le salon de l'hôtel des bains de Venise avec la famille princière polonaise en villégiature (Mort à Venise). ci-dessous : Madame de..., comtesse, essaie ses pendentifs devant son miroir en Murano (Max Ophüls).
En
France, à la veille de la première guerre mondiale, fortunes et revenus du
patrimoine étaient à un niveau astronomique
(sic). "En effet, la très forte concentration des
fortunes observée au début du XXe siècle est le produit d'un siècle
d'accumulation en période de paix : entre 1815 et 1914, les fortunes
grossissaient sans crainte ni de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les
successions (les taux d'imposition les plus élevés atteignaient des niveaux
dérisoires avant 1914)".
"Le fossé séparant les 0,01 % des revenus les plus
élevés (en pratique, toujours constitués pour une part prépondérante de revenus
du capital) de la moyenne des revenus était de l'ordre de 5 fois plus
considérable au début du XXe siècle qu'il ne l'est depuis 1945".
Le grand choc : 1914 - 1945
Le "grand
choc" - un des concepts-clé de Piketty - est
l’ensemble constitué par la guerre de 1914, l’inflation du début des années 20,
la crise de 29 et ses faillites, la seconde guerre mondiale.
"Si les inégalités de revenus se sont néanmoins réduites au XXe
siècle, cela tient pour l'essentiel aux chocs subis par les très hauts revenus
du capital. Les très gros patrimoines (et les très hauts revenus du capital qui
en sont issus) ont connu un véritable effondrement à la suite des crises de la
période 1914-1945 (destructions, inflation, faillites des années 1930)".
"Il fallut attendre les
traumatismes humains et financiers provoqués par les guerres mondiales et la
crise des années 1930 pour que la redistribution fiscale prenne une importance
déterminante" (Piketty signifie par là qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les inégalités
auraient déjà commencé à se réduire avant le déclenchement de la guerre de
1914).
"À l'issue des chocs de la période 1914-1945, les conditions de
l'accumulation de patrimoines importants se sont totalement transformées :
les taux supérieurs des impôts sur le revenu et sur les successions ont atteint
des niveaux extrêmement élevés (ceux appliqués aux revenus les plus élevés
dépassent les 90 % dès les années 1920)". "Il est devenu matériellement
impossible de retrouver des niveaux de fortunes comparables à ceux qui
prévalaient avant les chocs".
Le
graphique suivant indique les taux d’imposition des tranches les plus élevées,
aux États-Unis, à partir de 1916, année qui précède l’entrée en guerre décidée
par Wilson et la banque Morgan. 
 " (…) les Etats-Unis, outre qu'ils partaient de moins haut et que les chocs
y furent moins profonds qu'en Europe, se singularisent
par un très rapide retournement au cours des années 1980-1990 : en deux
décennies, les inégalités ont retrouvé le niveau qui était le leur à la veille
de la première guerre mondiale". Le graphique montre que c’est le démocrate Johnson
qui a fait descendre le taux d’imposition de la tranche de revenus la plus
élevée de 91 à 70%. Et c’est Nixon - républicain qui disait « nous sommes
tous des Keynésiens » - qui fait remonter à 78%. Mais évidemment c’est
Reagan qui fait entrer son pays dans l’ère des déficits massifs : avec
lui, en deux étapes, le taux supérieur d’imposition dégringole de 70 à 50% puis
de 50 à 28%. Les riches ne paient plus d’impôts ou presque, les déficits
s’envolent -car la course aux armements perd tout contrôle- mais le dollar
n’est plus « as good as gold »[5] : c’est du papier dans lequel tout le monde a
confiance. Enfin, jusqu’à présent. Parce que les Chinois commencent à se
méfier.
Quoiqu’il
en soit, répétons-le avec Piketty : en deux décennies, les inégalités ont
retrouvé le niveau qui était le leur à la veille de la première guerre mondiale.
Bien joué. Les Pigeons sont remplumés.
Un retour
au FORTUNES D’ANTAN est-il possible ?
Hôtel particulier construit en 1897 à Paris
"Les éléments d'histoire comparative peuvent fournir quelques pistes.
Dans tous les pays développés, les très gros patrimoines ont été très largement
laminés au cours des années 1914-1945. Pourquoi les pays européens, et la
France en tout premier lieu, ne finiraient-ils pas par suivre la trajectoire
américaine et par retrouver au cours des premières décennies du XXIe siècle la
très forte concentration des fortunes et des revenus qui prévalait à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle ?
Aussi incertaine soit-elle, l'idée d'un retour au XIXe siècle a
cependant un certain nombre de fondements objectifs. Tout d'abord, la
transformation des systèmes productifs observée dans les pays développés au
tournant du troisième millénaire : caractérisée par le déclin des secteurs
industriels traditionnels et le développement de la société de services et des
technologies de l'information (mais toutes les époques ont vu des secteurs
anciens décliner et des secteurs nouveaux émerger), elle a probablement pour
conséquence de favoriser un accroissement rapide des inégalités. En
particulier, la très forte croissance enregistrée dans les nouveaux secteurs
est de nature à permettre l'accumulation en un temps relativement bref de
fortunes professionnelles considérables. Ce phénomène a déjà été observé aux
Etats-Unis dans les années 1990, et l'on voit mal pourquoi il ne gagnerait pas
l'Europe.
De plus et peut-être surtout, la reconstitution au début du XXIe
siècle de très gros patrimoines d'un niveau comparable à ceux du début du
siècle est fortement facilitée par l'abaissement généralisé des taux marginaux
d'imposition frappant les revenus les plus élevés. Il est évidemment beaucoup
plus facile de constituer (ou de reconstituer) des patrimoines importants quand
les taux marginaux supérieurs sont de 30 % ou 40 % (voire nettement
moins, avec les exonérations particulières) que lorsque ces taux supérieurs
sont de 70 % ou 80 %, voire davantage, durant les « trente
glorieuses », notamment dans les pays anglo-saxons.
Aux États-Unis, et, dans une
moindre mesure, au Royaume-Uni, l'élargissement des inégalités patrimoniales
observé au cours des années 1980-1990 a été grandement facilité par les très
fortes baisses d'impôt dont ont bénéficié les revenus les plus élevés depuis la
fin des années 1970. En France et dans les pays d'Europe continentale, la
conjoncture politique et idéologique initiale était différente : alors que
la crise économique des années 1970 fut très vite interprétée par les opinions
anglo-saxonnes comme un aveu d'échec des politiques interventionnistes mises en
place à l'issue de la seconde guerre mondiale (à commencer par l'impôt
progressif), -on sait que Johnson
avait lancé un plan de lutte contre la pauvreté aux Etats-Unis, Reagan a eu ces
paroles fortes : la misère à gagné ! en foi de quoi, Reagan va
enrichir les riches (JPR) - les opinions
européennes ont pendant longtemps refusé de remettre en cause les institutions
associées à la période bénie de la croissance (comprendre les
éléments constitutif de l’Etat-Providence mis en place à la Libération pour ce
qui concerne la France et que la Droite et le MEDEF veulent faire disparaître
-JPR). Mais ce
grand écart transatlantique a fini par se réduire : outre que la
stagnation des pouvoirs d'achat constatée au cours des années 1980-1990 a
partout conduit à un certain rejet de l'impôt sur le revenu, l'existence
(réelle ou supposée) d'une mobilité de plus en plus forte des capitaux et des
« super-cadres » constitue aujourd'hui un puissant facteur poussant
les différents pays à s'aligner sur une fiscalité allégée pour les revenus en
question.
En conclusion :
Les
Américains, je parle des braves gens, sont aussi stupides et naïfs qu’ailleurs.
Le graphique ci-dessous montre que les 20% les plus riches des Américains se
partagent 83% des richesses réelles : il n’en reste que 17% pour les 80%
moins riches et très pauvres. Mais, trompés par leur illettrisme ou leurs
médias ou les évangélistes, les braves gens pensent que les 20% plus riches ont
60% des richesses à leur disposition et croient qu’ils en ont 40%. Leur souhait
(3° bâton du graphique) montre un grand désir d’égalitarisme. Même aux États-Unis.

2°
conclusion :
Je
copie/colle le chapeau de l’article de Piketty écrit en septembre 2001. "Afin de prévenir l'expatriation des
« investisseurs » que dissuaderait un environnement « peu
propice aux affaires », le gouvernement français envisage une nouvelle
baisse d'impôt destinée aux hauts revenus. Lorsqu'il s'agit des riches,
le
moins-disant fiscal est en effet devenu une mode internationale".
Qui
gouvernent en 2001 ? Chirac est à l’Élysée mais Jospin est premier
ministre avec un gouvernement gauche
plurielle. Peut-on parler d’une différence radicale entre l’UMP et
le
PS ?
Le
luxe de ce palais et des parures est à mettre en rapport avec
l'intérieur des fermes des paysans siciliens. Cette époque de l'unité
italienne date d'une précédente phase A ; celle de 1850 à 1873. (Le
guépard, de Visconti).
Last but not least, Pour les ouvriers aussi on
revient au XIX° siècle, MM. Arnault et Lagerfeld peuvent être satisfaits. A
votre avis de quand date ce texte ?
"Jamais mon père ne s'était trouvé
aux prises avec autant de difficultés. Il n'avait pas de travail et la fin de
ses ressources approchait. Il fallait absolument aviser. Il plaça ma sœur ainée
apprentie (…) ; puis mon frère Jean-Pierre, ‘…). Mon père et mon frère ainé
allèrent à la campagne chercher de l'ouvrage comme ouvriers (…). Après avoir
parcouru les environs de Lyon, ils finirent par en trouver à
Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Avant de prendre cette résolution qui devait nous
disperser, mon père lutta longtemps, il attendit d'être réduit à la dernière
extrémité ; il espérait toujours trouver une occupation à Lyon qui lui
permettrait de nous faire vivre tous ensemble.
Un des souvenirs les plus pénibles de mon
enfance se rapporte à ce temps. Nous n'avions que du pain sec à manger et de la
soupe maigre aux heures des repas. A mesure que les ressources diminuaient, mes
parents trouvaient que l'appétit de leurs enfants augmentait. En effet, ne
mangeant ni viande, ni œufs, ni fromage, nous avions toujours faim. Quand on
nous donnait du pain, nos parents nous disaient : «Vous n'aurez que ça, ne mangez pas trop vite». Un jour, mes parents
étaient inquiets, ils avaient engagé tout ce qu'ils avaient pu Crédit municipal,
il ne leur restait rien, le pain allait manquer. J'avais faim, je demandai à
manger. Ma mère me donna un peu de pain. Je la remerciai et, sans songer à la
situation critique où se trouvait notre famille, je me mis à sauter en dévorant
mon pain. Ma mère, qui était pourtant la meilleure des femmes se leva indignée
et me donna un soufflet en me disant : «Trouves-tu
que tu ne digères pas assez vite ? ». Je mis le reste du morceau de pain que
je mangeais sur la table et j'allais m'accroupir sur les carreaux dans un coin".
[1]
Les Hauts Revenus en France au XXe siècle - Inégalités et
redistributions,
1901-1998, Grasset, Paris, 812 pages, 196,80 francs (30 euros). (1)
L’enquête de Piketty s'appuie notamment sur une exploitation
systématique de
sources fiscales : les déclarations de revenus (qui apparaissent avec la
création de l'impôt sur le revenu en 1914), les déclarations de salaires
(qui
apparaissent avec la création d'un impôt sur les salaires en 1917), et
les
déclarations de succession (qui apparaissent avec la création de l'impôt
progressif sur les successions en 1901).on trouvera le texte intégral de l'article de Piketty par ce lien : SUR LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux fortunes d'antan, par Th. PIKETTY
[2]
Article de Christophe DEROUBAIX, "derrière
le duel Obama-Romney, la fin du rêve américain ?".
[3]
Grosso modo, on produit des richesses
pour les consommer, les exporter et amortir les investissements qui
permettront
de produire à nouveau. En période de grande prospérité, il y a un
reliquat que
les économistes appellent le surplus.
Le surplus fait le bonheur
de l’industrie du luxe, du gaspillage, des m’as-tu-vu, de ceux dont on
dit que
« l’argent leur brûle les doigts »…
[4]
Dixième fortune mondiale, en 1884. C’est la superficie d’un département
français.
[5]
Depuis les accords de la Jamaïque, 1976. |
|
publié le 22 févr. 2013, 01:21 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 22 févr. 2013, 01:48
]
publié le 8 mars 2012 10:34 par Jean-Pierre Rissoan
par Geoffrey
Geuens
Et d’abord qui est Geoffrey
Geuens ?
Chargé de
cours au département "arts
et sciences de la communication" de l’université de Liège, Geoffrey
Geuens
prend avec sérieux, sinon au sérieux, les discours publics d'un banquier
« de gauche » comme Jean Peyrelevade. "Rompre
avec le capitalisme, c'est rompre avec qui ? " interrogeait ce dernier
en
2005. "Mettre fin à la dictature du
marché, fluide, mondial et anonyme, c'est s'attaquer à quelles
institutions ?
(...) Marx est impuissant, faute d'ennemis identifié". Dans son
étude
saisissante des conseils d'administration des grandes institutions
financières,
de leur composition, des trajectoires entremêlées en politique et aux
affaires
de leurs dirigeants, des mariages qui lient entre elles les différentes
oligarchies nationales[1] ,
l'universitaire recourt aux armes de la sociologie pour dresser une
précieuse cartographie des classes dominantes en Europe et dans le
monde, avec
la perspective assumée de ne plus "laisser
impensés les véritables bénéficiaires du système et de la crise des
dettes
publiques". dans ce souci d'incarner, c'est-à-dire de donner
chair, à l'invisible (soi-disant), on retrouvera l'étude de chercheurs
suisses que j'ai reproduite ici-même sous le titre MAIS
QUI SONT LES AGENTS DES MARCHES FINANCIERS ? NB. le
souligné en bleu l'a été par moi-même JPR.
Entretien
réalisé par Thomas Lemahieu
Dans
votre ouvrage, vous démolissez une série de lieux communs qui
saturent aujourd'hui le débat public : la finance serait insaisissable,
hors de
portée du pouvoir, elle serait, comme l'a dit François Hollande dans un
passage
fameux de son discours du Bourget, «sans visage» car elle « ne se
présente pas
aux élections »..Que pensez-vous de ce type de déclarations politiques ?
GEOFFREY
GEUENS. Ce discours de
François Hollande est en effet extraordinaire car il synthétise
l'idéologie
dominante, la doxa, de
manière éclatante. La
difficulté, c'est de prendre de la distance avec des concepts rabâchés
par la
science politique la plus sclérosée, des grilles de lecture aussi
répandues
dans le débat public que les oppositions entre l’Etat et les marchés, le
public
et le privé, la politique et l'économie... Quand on en reste au niveau
des généralités,
ces oppositions tiennent la route, mais en se rapprochant du terrain,
ces
concepts académiques finissent par faire obstacle à la réflexion. A cc
niveau-là, les frontières étanches deviennent bien plus poreuses : quand
on
regarde dans une perspective sociologique comment fonctionnent l'Etat et
le
marché, on se rend compte que les trajectoires biographiques voient les
dominants passer d'un espace professionnel à l'autre. Les hommes d'Etat
deviennent
des hommes d'affaires, les hommes d'affaires deviennent hommes d'Etat.
Dès
lors, ce qui est en jeu, c'est là consolidation de la classe dominante.
Derrière
les oppositions entre les marchés financiers et les États, je vois
l'unité
d'une classe dont les membres passent allègrement d'un espace à
l'autre...
Qu’est-ce
qui vous conduit à-décrire comme une fiction les marchés
financiers que vous désignez entre guillemets ? -
GEOFFREY
GEUENS. Le « marché »,
je ne sais pas ce que c’est en réalité... Je connais des entreprises,
des
grandes familles, des fonds d'investissement, des actionnaires, des
groupes de pression
etc. Cela, ça existe ! Mais des marchés qui gouverneraient le monde,
comme on
l'entend chez les altermondialistes, je ne vois pas bien ce que cela
signifie
concrètement... Face à ces « marchés », on nous explique qu'il s'agirait
de permettre à l'État de « reprendre la
main ». Mais il en va de même pour 1'Etat : je ne sais pas trop ce
que
c'est, je connais des institutions, des banques centrales, des
Parlements, des
exécutifs, des hommes politiques... Derrière ces deux entités
abstraites, à la
fois désincarnées et distantes, ce que l'on constate quand on va y voir
de plus
près c'est qu'il y a des liens très étroits entre les uns et les autres.
Depuis
une bonne dizaine d'années, le discours critique du capitalisme se
limite, pour
l'essentiel, à une dénonciation des « marchés financiers » ou du «
néolibéralisme
». Ces termes tombent, à mon sens, à côté de la plaque. En dehors du
discours
d'accompagnement qu'il constitue, le néolibéralisme n'existe pas. Il
supposerait une extériorité réciproque du marché et de l'État, avec la
concurrence effrénée comme paradigme absolu dans un univers totalement
dérégulé.
Or, en réalité, le système ne fonctionne pas du tout ainsi : le
capitalisme
reste très centré sur les États, avec beaucoup de cartels et
d'interpénétrations... La confusion entretenue entre des termes comme
« capitalisme »
et « néolibéralisme » me paraît très néfaste au moment où, dans une
période de crise comme celle que nous connaissons, il s’agit de
construire les
groupes sociaux, de renforcer les consciences politiques, d’identifier
des
adversaires et de mener le combat.
« La
finance, mon
adversaire, n’a pas de visage, et elle ne se présente pas aux
élections »,
a dit le candidat socialiste à l’élection présidentielle. Il est plus confortable de dénoncer la finance
que de s'en prendre aux acteurs réels de la banque et de la grande
industrie.
Un tel projet obligerait François Hollande, il est vrai, à s'attaquer
aux
privilèges de certains de ses propres conseillers et de ses ex-collègues
européens reconvertis dans le monde des affaires
Selon
vous, concentrer la lumière sur ces «marchés» sert à occulter
l’adversaire qui est l'oligarchie...
GEOFFREY
GEUENS. En principe,
dans une démocratie, la politique, c'est le conflit, le choc des
confrontations. Mais à partir du moment où l'adversaire désigné est
aussi éloigné
que les « marchés financiers », comment fait-on ? Je m'inscris dans
le paradigme d'une sociologie critique, à la fois bourdieusienne et
marxiste;
et je me
reconnais entièrement dans les travaux de Monique Pinçon-Charlot et
Michel
Pinçon en parlant, comme eux, d'oligarchie, ce qui permet de
désigner la fraction hégémonique des classes dominantes.
Allez
convaincre l'ouvrier
d'Arcelor-Mittal à Liège ou à Florange qu'il doit lutter contre la
finance ! Ce
discours sur les « marchés financiers » peut s'avérer très
démobilisateur parce
qu'il efface les groupes sociaux qui dominent les classes populaires et
une
bonne partie des couches moyennes… Cela peut paraître ringard, mais si
l'on
veut s'adresser à ceux qui ont conquis toutes les avancées sociales dans
nos pays,
il faut repartir des réalités incarnées, ne pas se laisser entraîner
dans
l'éther de la mondialisation financière, établir les combats chez nous
dans les
limites, d'abord, de l'État-nation parce
que c'est à ce niveau-là que le
capitalisme continue prioritairement de se structurer, et pas
à
l'échelle globale !
Vous
évoquez les Pinçon-Charlot...Qu'apportent les outils d’une
sociologie des dominants dans le monde opaque des fonds
d'investissement, par
exemple ?
GEOFFREY
GEUENS. Les fonds
d'investissement et les hedge funds
constituent une espèce de terra incognita
: c'est présenté comme de l'argent électronique qui circule dans
l'opacité
totale sur toute la planète, mais ce sont en fait des entreprises qui
ont des
gestionnaires. Et, dans ce monde-là aussi, les dirigeants passent d'un
espace à
l'autre... Il n'y a pas d'un côté un capitalisme agressif -celui des hedge
funds- et un autre qui serait
civilisé, c'est le même ! Aux États-Unis, le
plus grand gestionnaire de hedge funds, c'est JPMorgan,
le trust américain par
excellence. En Europe, ce sont les mêmes logiques : ici aussi, on a des
familles, des liens entre les dirigeants. On trouve un bon exemple de
vieilles
familles industrielles qui changent pour
que rien ne change avec les
Wendel, passés des forges au capital-investissement. Dans le monde du
capitalisme financier, tout est très politique, très proche de l'État,
et il
n'est ni plus ni moins sauvage que le capitalisme -traditionnel, pas
moins lié
au pouvoir... Dans un secteur qui apparaît, de l'extérieur; comme très
anglo-saxon, on retrouve aussi en-réalité la reproduction la plus
classique de
l'oligarchie française.
Autre
exemple flamboyant de ces interpénétrations entre Etat et
marchés, les agences de notation...
GEOFFREY
GEUENS. Quand on étudie
de près l'actionnariat et le profil des dirigeants de ces agences, on
retrouve
un maillage d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, de gauche[2]
comme de droite... Les agences ne sont pas non plus désincarnées, ce
sont des
entreprises privées qui jouent du capitalisme de connivence. Alors
qu'avant la
crise, comme le note l'économiste Jacques Généreux, personne ne
s'occupait de
ce qu'elles disaient, les agences de
notation sont devenues incontournables, ce
sont des alibis pour imposer l'austérité. Cela ne veut pas
dire
qu'il y a un complot, mais simplement l'expression d'affinités
structurelles au
sein de la classe dominante.
À l’aune
de votre critique de l’intrication entre l'État et les marchés
que penser de l’inflation de gouvernements « techniques » à l'occasion
de
la crise des dettes publiques ?
GEOFFREY
GEUENS. En Italie, on
présente dans les médias le gouvernement de Mario Monti comme celui des
« experts », de « sages » de la « société civile ».
Là, ça devient magnifique ! Il serait composé d'un seul banquier, PDG
d'un
établissement financier, puis d'une kyrielle de professeurs d'économie à
l'université. Ce sont eux, les « sages » ! Mais en étudiant leurs
trajectoires, on constate qu'ils siègent tous dans les conseils
d'administration des banques..: Donc; en
fait de gouvernement de la « société civile »,
on a plutôt un gouvernement de banquiers ! Ces étiquettes
servent à
faire passer la pilule, c'est un gouvernement du monde des affaires ! Et
c'est
le même mouvement en Grèce avec Lucas Papademos... Pendant les crises,
les
masques tombent : en Grèce, c'est
éclatant, la socia1-démocratie est au
gouvernement avec la droite et, jusqu'à il y a peu, l'extrême droite,
pour imposer
l'austérité. Sous couvert d'expertise et de gouvernement des
« sages
», c'est la démocratie que l'on confisque au profit immédiat et exclusif
des
classes dominantes...
Votre
livre, et c'est tout son intérêt fourmille d'informations sur ces
oligarques du monde entier… Mais si vous deviez en citer quelques-uns,
qui choisiriez-vous
?
GEOFFREY
GEUENS. Jacques de
Larosière, c'est un bon exemple. Il a été choisi par la
Commission
européenne pour établir un rapport sur la crise en 2008. Dans cette
situation,
les institutions européennes font comme on fait aux Etats-Unis : on va
prendre
un membre de l'establishment politico-financier
qui a tous les signes extérieurs de la respectabilité publique,
politique,
étatique. Un homme d'État, Jacques de Larosière : c'est l’ancien
gouverneur de
la Banque de France et patron du FMI... C'est un « sage ». Il a été à la
tête
d'autres commissions, où déjà il s'agissait de surveiller les marchés
même si
visiblement, ça n'a pas marché ! Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au
moment
où il rédige le rapport pour la Commission européenne, il est aussi
conseiller
du président de BNP-Paribas, du trust financier BMB - contrôlé par
certaines
pétromonarchies du Golfe - et ancien conseiller d'AIG, premier assureur
mondial, sauvé de la faillite en 2008 par la FED. Cela démontre bien la
dimension de l'oligarchie : c'est un Français qui défend les intérêts
des
groupes financiers français, mais avec un ancrage et un capital social
internationaux.
En
Grande-Bretagne, le
gouvernement de Gordon Brown avait nommé Paul Myners comme secrétaire
d'État aux
Services financiers mais il a fini par faire l'objet de controverses
lorsque
l'on a appris qu'il siégeait dans des hedge
funds immatriculés dans des paradis fiscaux (Bermudes, Jersey...).
C'est
extraordinaire. On ne peut pas croire que ça soit un incident, une
erreur de
casting, évidemment ! Cela montre que le discours de la régulation,
c'est du
pipeau complet ! En période de crise, c'est le minimum syndical
idéologique de
l'oligarchie, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est
un jeu
de dupes.
Du côté
de ceux qui apparaissent
moins comme des techniciens que comme des vrais politiques, on va de
surprise
en surprise. Tous les anciens dirigeants de ces vingt dernières années
qui ont
incarné la « troisième voie » et le social-libéralisme, tous ces gens qui ont démantelé l'État-providence
dans leurs pays, attaqué les droits sociaux un à un, les Tony
Blair,
Gerhard Schröder (Rothschild, TNK-BP), Wim Kok (Shell, ING), Göran
Persson
(JKL/Publicis), passent
dans la communauté des affaires pour services rendus. Avec
son
visage jovial de grand-père, Romano Prodi, le « technicien » par
excellence, personnalité
de centre gauche et ex-président du Conseil italien, est membre du
comité
international de la compagnie pétrolière BP, aux côtés de Javier Solana
et de
l'ex-chef de cabinet de George W Bush. Kofi Annan, l'ancien secrétaire
général
de l'ONU, vient de rejoindre le comité international de JPMorgan Chase
présidé
par Tony Blair, tout en ayant aussi, par ailleurs, épousé une
Wallenberg, la
plus grande dynastie d'affaires suédoise.
Pour
revenir en France, après sa déclaration tonitruante au Bourget,
Français Hollande a, quelques semaines plus tard, déclaré à la presse
anglo-saxonne qu'elle n'avait pas d'inquiétude à avoir puisque les
socialistes
avaient libéralisé les marchés...Y a-t-il un retournement ?
GEOFFREY
GEUENS. François
Hollande a affirmé à plusieurs reprises qu'il serait aussi le candidat
de la
«rigueur juste » ; on sait ce que cela signifie... Aujourd'hui, ce qu'il
faut faire, c'est faire bloc et refuser l'austérité en bloc, décidée non
pas
par des « marchés financiers », mais bel et bien par des gouvernements, y
compris sociaux-démocrates... Dénoncer, pendant la campagne, les «
marchés
financiers » pour mieux faire ava1er, ensuite, la pilule de l'austérité,
c'est
vieux comme le monde ; et, pourtant, certains vont encore tomber dans le
piège...
L’Humanité
des 2-3-4 mars 2012, l’Humanité des
débats.
[1]
"La Finance imaginaire, Anatomie du
capitalisme : des "marchés financiers" à l'oligarchie", de
Geoffrey Geuens, éditions Aden, Bruxelles, 368 pages, 25 euros.
[2]
Laquelle ? il y en a au moins deux (JPR)…
|
|
publié le 22 févr. 2013, 01:19 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 22 févr. 2013, 01:48
]
publié le 24 oct. 2012 11:50 par Jean-Pierre Rissoan
Soucieux du respect qu’on doit à
un auteur et à son texte, je publie intégralement l’article de Thomas Piketty publié
dans le numéro du Monde diplomatique de septembre 2001.[1]
je vous renvoie à l’article que cet article m’a inspiré avec le non moins remarquable
article de DEROUBAIX dans l’Huma-dimanche d’octobre 2012. Onze ans d’écart
entre les deux articles mais ils se
complètent à merveille.
1914 -2014 : patrimoines et
revenus du patrimoine, ça explose !
.J.-P.R.
SUR LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux
fortunes d'antan
Par Thomas PIKETTY
Afin
de prévenir l'expatriation des « investisseurs » que dissuaderait un
environnement « peu propice aux affaires », le gouvernement français
envisage une nouvelle baisse d'impôt destinée aux hauts revenus. Lorsqu'il
s'agit des riches, le moins-disant fiscal est en effet devenu une mode
internationale. La Russie a déjà supprimé la progressivité de l'impôt,
l'Argentine envisage de le faire. Quant aux Etats-Unis, la richesse y est
toujours aussi concentrée et aussi « blanche ».
Comment
les inégalités de revenus, de salaires et de patrimoines ont-elles évolué en
France au cours du XXe siècle, et pourquoi ? Cette enquête repose sur des
sources fiscales qui n'avaient jamais été véritablement exploitées sur une
longue période, et sur l'analyse des discours et programmes politiques en
matière de redistribution.
Les
inégalités se sont réduites en France au XXe siècle[2].
Mais, contrairement à ce que certaines théories optimistes pourraient laisser
croire, cette réduction ne ressemble en rien à un phénomène généralisé et
irréversible. En particulier, on constate que l'inégalité des salaires, au-delà
des multiples fluctuations de court et moyen terme, n'a en réalité pratiquement
pas changé. Par exemple, les 10 % des salariés les mieux rémunérés ont
toujours disposé d'un salaire moyen de l'ordre de 2,5 à 2,6 fois le salaire
moyen de l'ensemble de la population ; les 1 % des mieux rémunérés
ont toujours reçu un salaire moyen de l'ordre de 6 à 7 fois le salaire moyen de
l'ensemble de la population...
Les
différentes formes de travail humain se sont totalement transformées entre les
deux extrémités du siècle, et le pouvoir d'achat moyen a été multiplié par 5
environ, mais la hiérarchie des rémunérations est restée la même. Cette
impressionnante stabilité doit sans doute être mise en parallèle non seulement
avec la permanence des écarts de qualifications et de formations, mais
également avec le très large consensus qui a toujours entouré ces hiérarchies
salariales : l'inégalité des salaires n'a jamais été véritablement remise
en cause par quelque mouvement politique que ce soit.
Si
les inégalités de revenus se sont néanmoins réduites au XXe siècle, cela tient
pour l'essentiel aux chocs subis par les très hauts revenus du capital. Les
très gros patrimoines (et les très hauts revenus du capital qui en sont issus)
ont connu un véritable effondrement à la suite des crises de la période
1914-1945 (destructions, inflation, faillites des années 1930).
Les
décennies qui se sont écoulées depuis 1945 n'ont toujours pas permis à ces
fortunes et à ces revenus de retrouver le niveau astronomique qui était le leur
à la veille de la première guerre mondiale. L'explication la plus convaincante
est liée à l'impact dynamique de l'impôt progressif sur l'accumulation et la
reconstitution de patrimoines importants.
En
effet, la très forte concentration des fortunes observée au début du XXe siècle
est le produit d'un siècle d'accumulation en période de paix : entre 1815
et 1914, les fortunes grossissaient sans crainte ni de l'impôt sur le revenu ni
de l'impôt sur les successions (les taux d'imposition les plus élevés
atteignaient des niveaux dérisoires avant 1914). A l'issue des chocs de la
période 1914-1945, les conditions de l'accumulation de patrimoines importants
se sont totalement transformées : les taux supérieurs des impôts sur le
revenu et sur les successions ont atteint des niveaux extrêmement élevés (ceux
appliqués aux revenus les plus élevés dépassent les 90 % dès les années
1920).
Il
est devenu matériellement impossible de retrouver des niveaux de fortunes
comparables à ceux qui prévalaient avant les chocs. L'ampleur des
transformations ainsi induites mérite d'être soulignée : le fossé séparant
les 0,01 % des revenus les plus élevés (en pratique, toujours constitués
pour une part prépondérante de revenus du capital) de la moyenne des revenus
était de l'ordre de 5 fois plus considérable au début du XXe siècle qu'il ne
l'est depuis 1945. Ce ne sont pas les revenus du capital en tant que tels qui
ont disparu, mais plutôt leur concentration qui s'est fortement réduite :
le partage global du revenu national entre revenus du travail et revenus du
capital a été stable en France au cours du siècle, mais les répartitions à l'intérieur
de chacune de ces catégories ont évolué de façon totalement différente (la
répartition des revenus du travail n'a pratiquement pas changé, alors que celle
des revenus du capital s'est fortement comprimée).
En
outre, rien ne permet de conforter l'idée selon laquelle les inégalités
auraient déjà commencé à se réduire avant le déclenchement du premier conflit
mondial. En l'absence des chocs des années 1914-1945, il est probable que la
France n'aurait pas quitté de sitôt le sommet inégalitaire du début du siècle
dernier. En particulier, il fallut attendre les traumatismes humains et
financiers provoqués par les guerres mondiales et la crise des années 1930 pour
que la redistribution fiscale prenne une importance déterminante.
Cela
ne signifie pas nécessairement qu'il faille considérer la compression des
inégalités comme due au hasard des événements guerriers ou boursiers. Il n'est
pas interdit de voir dans les crises des années 1914-1945 une réponse endogène
à l'inégalité insoutenable qui caractérisait alors le capitalisme.
Un
retour au XIXe siècle est-il possible ? Les éléments d'histoire
comparative peuvent fournir quelques pistes. Dans tous les pays développés, les
très gros patrimoines ont été très largement laminés au cours des années
1914-1945. Mais les Etats-Unis, outre qu'ils partaient de moins haut et que les
chocs y furent moins profonds qu'en Europe, se singularisent par un très rapide
retournement au cours des années 1980-1990 : en deux décennies, les
inégalités ont retrouvé le niveau qui était le leur à la veille de la première
guerre mondiale. Pourquoi les pays européens, et la France en tout premier
lieu, ne finiraient-ils pas par suivre la trajectoire américaine et par
retrouver au cours des premières décennies du XXIe siècle la très forte
concentration des fortunes et des revenus qui prévalait à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle ?
Une
telle prédiction est certes extrêmement risquée. L'examen détaillé du siècle
passé montre en effet que l'histoire des inégalités est largement imprévisible.
En particulier, l'inégalité des salaires, en dépit de sa très grande stabilité
séculaire, a connu au cours du XXe siècle une alternance complexe de phases de
compression et d'élargissement. Les ruptures de cette histoire ont souvent été
les mêmes que celles de l'histoire générale de la France : outre les deux
guerres mondiales, qui ont conduit à des compressions importantes des
hiérarchies salariales, vite comblées lors de chacun des deux après-guerres,
1936, 1968 et 1982-1983 constituent également des tournants importants dans
l'histoire de l'inégalité des salaires. Il serait fort étonnant que l'on
n'observe pas le même type de fluctuations et de ruptures au cours de ce
siècle ; il serait présomptueux de prétendre pouvoir les prévoir.
Aussi
incertaine soit-elle, l'idée d'un retour au XIXe siècle a cependant un certain
nombre de fondements objectifs. Tout d'abord, la transformation des systèmes
productifs observée dans les pays développés au tournant du troisième
millénaire : caractérisée par le déclin des secteurs industriels
traditionnels et le développement de la société de services et des technologies
de l'information (mais toutes les époques ont vu des secteurs anciens décliner
et des secteurs nouveaux émerger), elle a probablement pour conséquence de
favoriser un accroissement rapide des inégalités. En particulier, la très forte
croissance enregistrée dans les nouveaux secteurs est de nature à permettre
l'accumulation en un temps relativement bref de fortunes professionnelles
considérables. Ce phénomène a déjà été observé aux Etats-Unis dans les années
1990, et l'on voit mal pourquoi il ne gagnerait pas l'Europe.
De
plus et peut-être surtout, la reconstitution au début du XXIe siècle de très
gros patrimoines d'un niveau comparable à ceux du début du siècle est fortement
facilitée par l'abaissement généralisé des taux marginaux d'imposition frappant
les revenus les plus élevés. Il est évidemment beaucoup plus facile de
constituer (ou de reconstituer) des patrimoines importants quand les taux
marginaux supérieurs sont de 30 % ou 40 % (voire nettement moins,
avec les exonérations particulières) que lorsque ces taux supérieurs sont de
70 % ou 80 %, voire davantage, durant les « trente glorieuses »,
notamment dans les pays anglo-saxons.
Rentiers
ou entrepreneurs ?
Aux
Etats-Unis, et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni, l'élargissement des
inégalités patrimoniales observé au cours des années 1980-1990 a été grandement
facilité par les très fortes baisses d'impôt dont ont bénéficié les revenus les
plus élevés depuis la fin des années 1970. En France et dans les pays d'Europe
continentale, la conjoncture politique et idéologique initiale était
différente : alors que la crise économique des années 1970 fut très vite
interprétée par les opinions anglo-saxonnes comme un aveu d'échec des
politiques interventionnistes mises en place à l'issue de la seconde guerre
mondiale (à commencer par l'impôt progressif), les opinions européennes ont
pendant longtemps refusé de remettre en cause les institutions associées à la
période bénie de la croissance.
Mais
ce grand écart transatlantique a fini par se réduire : outre que la
stagnation des pouvoirs d'achat constatée au cours des années 1980-1990 a
partout conduit à un certain rejet de l'impôt sur le revenu, l'existence
(réelle ou supposée) d'une mobilité de plus en plus forte des capitaux et des
« super-cadres » constitue aujourd'hui un puissant facteur poussant
les différents pays à s'aligner sur une fiscalité allégée pour les revenus en
question.
Tout
semble donc concourir à faire des premières années de ce siècle des années
fastes pour les détenteurs de patrimoines. Mais cette conjoncture économique et
intellectuelle durera-t-elle ? L'expérience du XXe siècle suggère que des
sociétés trop évidemment inégales sont intrinsèquement instables. L'étude du
siècle passé confirme qu'une trop forte concentration du capital peut avoir des
conséquences négatives en termes d'efficacité économique, et pas seulement du
point de vue de la justice sociale. Il est fort possible que l'aplatissement
des inégalités patrimoniales survenu au cours de la période 1914-1945, en
accélérant le déclin des anciennes dynasties capitalistes et en favorisant
l'émergence de nouvelles générations d'entrepreneurs, ait contribué à dynamiser
les économies occidentales des « trente glorieuses ». L'impôt
progressif a le mérite d'empêcher que se reconstituent des situations analogues
à celle qui prévalait à la veille de la première guerre mondiale, et sa mise à
mal pourrait avoir pour effet de long terme une certaine sclérose économique.
[1]
Cet article reprend les principales conclusions du livre Les Hauts Revenus
en France au XXe siècle - Inégalités et redistributions, 1901-1998,
Grasset, Paris, 812 pages, 196,80 francs (30 euros).
[2]
Cette enquête s'appuie notamment sur une exploitation systématique de sources
fiscales : les déclarations de revenus (qui apparaissent avec la création
de l'impôt sur le revenu en 1914), les déclarations de salaires (qui
apparaissent avec la création d'un impôt sur les salaires en 1917), et les
déclarations de succession (qui apparaissent avec la création de l'impôt
progressif sur les successions en 1901).
|
|
publié le 22 févr. 2013, 01:18 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 22 févr. 2013, 01:48
]
publié le 15 nov. 2011 18:30
par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 21
nov. 2011 12:01
]
Cet
article est un daille-geste
-un digest, si vous préférez- d’un dossier sur "Les
50 maîtres du Monde" et présenté de la sorte : "Qui sont ces marchés
que Sarkozy et ses
compères du G20 veulent rassurer à tout prix ? Derrière la fameuse
« main invisible » se cachent 50 mastodontes financiers qui
contrôlent l’essentiel de l’économie mondiale"[1].
Il y a
peu, trois économistes[2]
de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich se sont penchés sur ce que
pouvaient être la place et le rôle des grosses entreprises, les firmes
multinationales, FMN, sur l’économie mondiale. Il en est sorti une
somme :
"The
Network of Global Corporate Control". Leur étude a exploité
des
données de 2008 de l’OCDE soit un échantillon de 43060 FMN. A l’issue de
calculs mathématiques aussi complexes que la réalité étudiée, ces
chercheurs
sont arrivés à la conclusion que, parmi ces 43060 firmes, certaines
étaient "plus
égales" que d’autres. Par le jeu -mot détestable qui dissimule la
réalité
humaine- par le jeu des participations au capital des FMN, des majors
ont plus
de pouvoir que d’autres : en fait, elles les dirigent. 737 FMN sont des
« détenteurs prépondérants » et cumulent 80% du contrôle de la valeur
de toutes les FMN prises en compte. Au sein de ces 737 sociétés, les
trois
chercheurs ont découvert 147 FMN qui s’interpénètrent par des
investissements
croisés (je possède 2% de tes actions et toi tu possèdes 3% des miennes,
etc…)
et qui, tout en se contrôlant elles-mêmes entre elles, possèdent 40% de
la
valeur économique et financière de toutes les FMN du MONDE. Encore plus
"happy
few", 50 sociétés parmi ces 147 sont des "super-entités". Ce
sont des banques, des compagnies d’assurances et des fonds
d’investissement ou
de pensions. Les voici par ordre d’importance :
1.
BARCLAYS PLC (Grande-Bretagne)
2.
THE CAPITAL GROUP COMPANIES
INC (États-Unis)
3.
FMR CORP (États-Unis)
4.
AXA (France)
5.
STATE STREET CORPORATION (États-Unis)
6.
JPMORGAN CHASE & CO (États-Unis) (États-Unis)
7. LEGAL &
GENERAL GROUP
PLC (Grande-Bretagne)
8. THE VANGUARD GROUP, INC. (États-Unis)
9. UBS AG
(Suisse)
10.
MERRILL LYNCH
& CO., INC. (États-Unis)
11.
WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P. (États-Unis)
12.
DEUTSCHE BANK AG (Allemagne)
13.
FRANKLIN RESOURCES, INC. (États-Unis)
14.
CRÉDIT SUISSE GROUP
(Suisse)
15.
WALTON ENTERPRISES LLC (États-Unis)
16. BANK
OF NEW
YORK MELLON CORP. (États-Unis)
17.
NATIXIS (France)
18.
GOLDMAN SACHS GROUP,
INC., (États-Unis)
19. T.
ROWE PRICE
GROUP, INC. (États-Unis)
20.
LEGG MASON, INC. (États-Unis)
21.
MORGAN STANLEY (États-Unis)
22.
MITSUBISHI
UFJ FINANCIAL GROUP, INC. (Japon)
23.
NORTHERN TRUST CORPORATION (États-Unis)
24.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (France)
25.
BANK OF AMERICA CORPORATION
(États-Unis)
26.
LLOYDS TSB GROUP PLC
(Grande-Bretagne)
27.
INVESCO PLC (Grande-Bretagne)
28.
ALLIANZ SE (Allemagne)
29.
TIAA (États-Unis)
30. OLD
MUTUAL
PUBLIC LIMITED COMPANY (Grande-Bretagne)
31.
AVIVA PLC (Grande-Bretagne)
32.
SCHRODERS PLC (Grande-Bretagne)
33. DODGE
& COX (États-Unis)
34.
LEHMAN
BROTHERS[3]
HOLDINGS, INC. (États-Unis) données de 2008.
35.
SUN LIFE FINANCIAL, INC. (Canada)
36.
STANDARD LIFE
PLC (Grande-Bretagne)
37.
CNCE (France)
38.
NOMURA
HOLDINGS, INC. (Japon)
39. THE
DEPOSITORY TRUST COMPANY
(États-Unis)
40.
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR. (États-Unis)
41.
ING GROEP N.V. (Pays-Bas)
42.
BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. (États-Unis)
43.
UNICREDITO ITALIANO SPA (Italie)
44.
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF
JP (Japon)
45.
VERENIGING AEGON (Pays-Bas)
46.
BNP PARIBAS (France)
47.
AFFILIATED
MANAGERS GROUP, INC. (États-Unis)
48.
RESONA
HOLDINGS, INC. (Japon)
49.
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL,
INC. (États-Unis)
50. CHINA
PETROCHEMICAL GROUP CO.
(Chine)
Au total,
on a là 33 entreprises
anglo-saxonnes (24 américaines, 8 britanniques et 1 canadienne) soit
66%. Sur
les 10 plus importantes, 8 sont anglo-saxonnes (80%) et sur les 20
premières,
on en trouve 15 soit 75%, Et encore ne s’agit-il que d’une comptabilité
de
places dans le classement, il faudrait pouvoir cumuler le capital
de ces entités WASP pour mieux montrer l’emprise du
capital anglo-saxon sur le monde.
Cas concret :
ExxonMobil
Voici les
principaux actionnaires
du plus gros pétrolier au monde : EXXONMOBIL :
Vanguard
Group et fonds associés
(8e dans la liste des 50) : 7,20%
State Street Corporation (5°) : 4%
Bank of New York Mellon Corporation (16e) : l,58%
FMR Corp. (31) : 1,51 %
Wellington Management Company (11°) : 1,39%
Northern Trust (23e) : 1,33%
JPMorgan Chase & Co (6e) : 1,09%
Bank of America Corp. (25°) : 0,96 %
Compte
tenu de la capitalisation
financière d’ExxonMobil,
ces pourcentages -en apparence modestes- représentent des sommes
énormes.
Barclays :
primus inter pares
Barclays a
son siège à la City de
Londres où se côtoient 550 banques et la moitié des plus gros assureurs
de la
planète. Elle est dirigée par un Américain : on reste entre amis, les
WASP. Cette banque possède plus de 300 filiales dans les paradis
fiscaux :
181 aux îles Caïmans, 38 à Jersey, 30 à Man, etc... Soit le plus gros
potentiel
d’évasion fiscale de la City écrit Marc de Miramon. Mais chez Barclays
on ne
parle pas avec de gros mots, on dit "optimisation fiscale". Les Iles
Caïmans sont un T.O.M. (territoire d’outre-mer) du Royaume-Uni. L’île de
Man a également
un statut spécial. Elle dépend directement de la Couronne britannique et
non
pas du parlement de Westminster. Il en va de même de l’île de Jersey.
Capital
Group Companies inc.
C’est un
fonds de pensions.
Les
ramifications de cette firme
fondée en 1931, en pleine dépression mondiale, sont surprenantes, en
particulier dans les sociétés du CAC 40: 10% du capital d'Air France (4400 suppressions de postes prévus d’ici à 2013),
5%
de la Société générale, 5% de Schneider Electric (1000
emplois supprimés en 2009 et 1000 intérimaires menacés aujourd’hui en
France),
10% de Suez Environnement, 5 % de Rhodia ... Même omniprésence au sein
des
sociétés allemandes : Bayer (10%) ou Continental (5%) (1100 salariés licenciés suite à la fermeture de
l’usine de
Clairoix dans l’Oise) ; sans oublier la Grèce. CGC inc. a des
participations significatives au sein de l'OPAP, la principale société
de
loterie numérique et de paris sportifs en Europe, le géant du BTP
Ellaktor, ou
du ciment Titan.
FMR
corporation
Les
activités du fonds de pension
FMR Corp., 3e firme du classement, proposent, à travers ses filiales,
tous les
services financiers aux quatre coins du globe : l'investissement dans
les
secteurs publics (Fidelity Tax Exempt Services Company), les retraites
japonaises
(Fidelity Group Pensions Japan), les investissements dans les
entreprises
canadiennes (Fidelity Investments Canada Ltd) et même une branche dédiée
à "l’optimisation
fiscale" (sic, déjà vu) avec Fidelity Investments Tax exempt Services
company. "Tax
exempt" : inutile de traduire.
Tout cela
présente des visages,
des hommes en chair et en os : "voilà
l’intronisation de Mario Monti, économiste, conseiller international de
Goldman
Sachs (18° rang mondial, cf. le tableau, JPR) depuis 2005, et désormais président du Conseil à
la tête de
l’Italie". Lien : http://www.placeaupeuple2012.fr/les-marches-font-la-loi/
Si l’on
ajoute aux 33 mastodontes
anglo-saxons, les 5 français, les 2 allemands, les 2 néerlandais et le
groupe italien,
nous avons là 43 des 50 plus grands financiers de la planète. Le projet
existe de
créer entre l’Europe des 27 et l’Amérique du Nord une vaste zone de
libre-échange
nord-atlantique. Les 43 y seront comme poissons dans l’eau et tout cela
sera protégé
in fine par l’OTAN.
L’ordre
mondial se met en place.
Les
peuples ont-ils dit leur
dernier mot ? ainsi que l'écrit le programme du Front de Gauche (p.10) :
"pour abolir les privilèges de notre
temps, il nous faudra assumer puis remporter le confrontation avec la
finance". La tâche sera rude. Mais le vent se lève...
[1]
Humanité-Dimanche, n°20779 du 27 octobre 2011. Dossier établi par
Dominique
Sicot et Marc de Miramon incluant un entretien avec Tristan Auvray,
Doctorant à
Toulouse-I .
[2]
Stefania Vitali, James B. Glattfelder et Stefano
Battiston.
[3]
L’étude a été effectuée à partir de données de 2008. Lehmann Brothers a
été mis
en faillite en septembre. Ses activités ont été reprises par Barclays et
par
Nomura. (note de l’Humanité-Dimanche).
|
publié le 22 févr. 2013, 01:17 par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 22 févr. 2013, 01:48
]
publié le 24 nov. 2011 12:24
par Jean-Pierre Rissoan
[
mis à jour : 24
nov. 2011 23:22
]
Mme
Deborah Hargreaves est
présidente du groupe britannique de recherche sur les hauts salaires
(High Pay
Commission). Ses recherches lui ont permis de constater que "la
hausse des inégalités a été telle durant
la période qui suit l’an 1980 que l’écart entre riches et pauvres en
Grande-Bretagne est comparable à celui de certains pays en développement".
Yves
Lacoste, géographe français
de notoriété, spécialiste de la géographie des pays en développement
disait - il
y a déjà quelques décennies - que dans les pays du Sud, dans les pays
sous-développés
"les richesses sont plus grandes et
la pauvreté est plus grande que dans les pays du Nord". Voilà une
disparité nord-sud qui a disparu. Egalisation par le bas.
Thomas
Piketti nous donne des
éléments d’explication. Durant le XX° siècle, les gros patrimoines ont
subi en
Europe occidentale surtout, mais globalement dans tous les pays riches,
une
sorte de nivellement à cause de troubles majeurs ; les deux guerres
mondiales et la crise de 1929. de plus, la démocratie politique évoluant
vers
un peu de démocratie sociale "les conditions de l'accumulation de
patrimoines importants se sont totalement transformées : les taux
supérieurs
des impôts sur le revenu et sur les successions ont atteint des niveaux
extrêmement élevés". Tant et si bien que "les traumatismes
humains et financiers ont donné à la redistribution fiscale une
importance
déterminante. (…). Les décennies qui se sont écoulées depuis 1945 n'ont
toujours pas permis (aux) fortunes et (aux) revenus de retrouver le
niveau
astronomique qui était le leur à la veille de première guerre mondiale".
Avant
1914, c’était "la Belle Epoque", et les fortunes
s’étalaient sans vergogne. On peut trouver des références
cinématographiques : la parade des chapeaux avant la course d’Ascot dans
le film My fair lady[1],
ou encore l’arrivée de la princesse russe et de ses enfants à l'Hôtel
des Bains
du Lido, grand hôtel de Venise, dans La
mort à Venise[2]… à
l’autre bout de l’échelle, dans les
caves de Lille, industrie textile, « on meurt sous vos plafonds de
pierre » ![3]
Ce qu'on
nous propose, ce à quoi
rêve le parti du Patrimoine, c'est un retour à la hiérarchie du XIX°
siècle.
Est-ce possible s'interroge Piketti ? Mme Deborah Hargreaves vient de
lui
donner une réponse. Mais cet économiste avait déjà constaté qu’aux
Etats-Unis
d'Amérique, "en deux décennies (1980-1990) les inégalités ont
retrouvé
le niveau qui était le leur à la veille de la 1ère guerre
mondiale"[4].
Ces deux décennies sont celles de la désastreuse « révolution
conservatrice » initiée par les Anglo-saxons : Thatcher en
Angleterre, 1979, R. Reagan aux Etats-Unis, 1981.
Piketti
avançait l'idée qu’un retour au XIX° siècle (avait)
un certain nombre de fondements objectifs" : la troisième
révolution industrielle, avec Bill Gates comme figure emblématique[5],
montre que "la très forte croissance enregistrée dans les nouveaux
secteurs est de nature à permettre l'accumulation en un temps
relativement bref
de fortunes professionnelles considérables". Avec l'idéologie du now-nowism,
du "tout-tout-de-suite", la pression est forte. Enorme. De plus,
l'expérience montre que la "baisse des taux marginaux supérieurs (de
70-80% à 30-40%) facilite la constitution (ou la reconstitution) des
patrimoines importants". Donc dépêchons-nous ! De plus, "la
stagnation des pouvoirs d'achat constatée (1980-1990) a partout conduit à
un
certain rejet de l'impôt sur le revenu (c'est le moins qu'on puisse
dire,
JPR)" et "la mobilité (réelle ou supposée) de plus en plus forte
des capitaux et des "super-cadres" conduit les différents pays à
s'aligner sur une fiscalité allégée pour les revenus en question".
Retour
aux hiérarchies du XIX°
siècle, alignement sur la hiérarchie des pays pauvres remplies de riches
insolents à la fortune nauséeuse ? On peut aussi dire retour aux
hiérarchies antiques. A Rome, sous l’Empire (II° NE), "les paysans
propriétaires de leur champ
vivent dans des chaumières misérables. (..)". Ils voient parfois
arriver "de jeunes bourgeois des
villes, qui viennent chasser dans le pays et qui portent avec eux plus
de
pièces d’or que n’en possèdent tous les habitants sur des milles à la
ronde".
De retour chez eux, ces jeunes gens pourront se délasser dans leur villa
de
plaisance "où naturellement il y a
des thermes et une piscine chaude en plein air, d’où, tout en nageant,
on peut
voir la mer"[6].
Comme au
bord de notre riviera ou
sur les côtes de Floride.
Ah ! il
fait bon vivre. Vive
l’Occident, Vivent les agences de notation.
rebondir : Le
courage en politique...
[1] Film de George Cukor, sorti en 1964.
[2]
Luchino Visconti, 1971.
[3]
Cri de révolte de V. Hugo observant le travail des enfants dans
l’industrie
textile.
[4]
T. Piketti signale toutefois que les Etats-Unis "partaient de moins
haut et les chocs (des deux guerres mondiales, JPR) y furent
moins
profonds qu'en Europe".
[5]
Rendons cette justice à Bill Gates : il s'est opposé au président G. W.
Bush
sur la question de la baisse des droits de succession. Il y est hostile.
[6]
D’après Pierre Grimal, "La
civilisation romaine", chez Artaud.
|
|


.jpg)